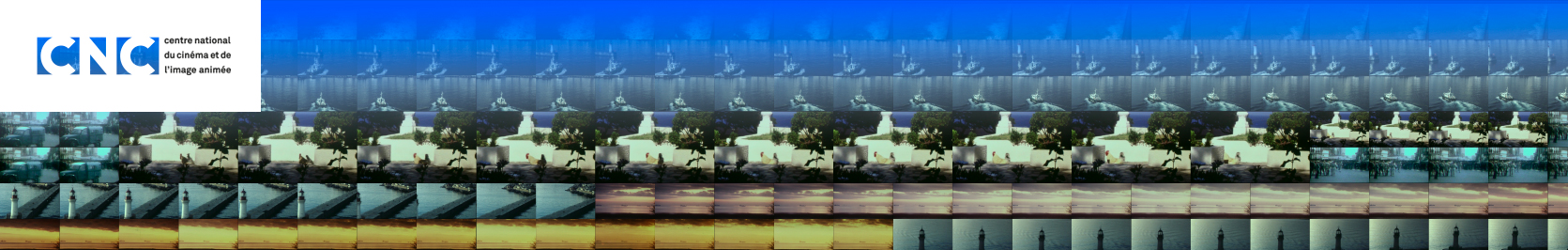Alchimies sonores

La première partie de Charlemagne Palestine, the Golden Sound évoque sa jeunesse à Brooklyn où il est né (en 1945 ou 1947 selon les sources, Charles Martin ou Chaim Moshe Tzadik Palestine), son apprentissage du chant dans une chorale de synagogue, avant de devenir à 16 ans, carillonneur de l'église épiscopale St-Thomas sur la 5e avenue à Manhattan. Dans l'instrumentarium de Charlemagne Palestine, le carillon occupe une place emblématique aux côtés du synthétiseur analogique Buchla, du grand piano Bösendorfer Imperial, et maintenant du piano à deux claviers, le “doppio borgato” construit sur mesure par le facteur d'instruments italien Luigi Borgato.
Les moments forts du film sont ceux où Charlemagne est saisi en train de jouer sa musique : dans un vaste loft immaculé trône la machinerie complexe du carillon, magnifique cube de métal, mécanique de précision ténébreuse, câbles, pédales et cloches, à l'origine de la technique du strumming (littéralement : acte de faire sonner des cordes, de piano, de guitare...), qui structure toute sa musique pour piano depuis les années 1960. Régal d'une petite pièce cristalline, chorégraphie du jeu de mains et de pieds, choral de cloches dont les résonances fluctuantes enveloppent l'auditeur dans un nuage d'harmoniques célestes... Plus tard, dans une petite église italienne, on assiste au déploiement du “borgato”, deux grands pianos superposés, dont le clavier de l'un est relié à un système de pédales. Impressionnante présence de cet objet d'aspect surréaliste dont le sombre verni et la riche vibration occupent tout l'espace...
Aux commandes de ce vaisseau sonore, Charlemagne martèle avec grâce et une extrême concentration les différents mouvements de From Etudes to Cataclysms. La séquence musicale fait l'objet d'un enregistrement : le compositeur et les techniciens évaluent les propriétés acoustiques de l'église, tandis que Charlemagne réécoute une prise en exécutant une petite danse sur place. Enfin, face à un auditoire très jeune, il partage la scène avec son complice de longue date, le violoniste Tony Conrad, autre légende du minimalisme, pionnier du drone, des systèmes d'accordage mathématiques et du cinéma expérimental. Tous deux chapeautés façon bohème urbaine, Charlemagne Palestine vocalise un verre à la main, Tony Conrad virevolte, tandis que son violon harmonise. Surgissant des fantômes de la jeunesse – le chaman, le clown, le Quasimodo des années 1970, ses rituels, sa folie, parfois sa violence... – ces vieux messieurs aussi débonnaires qu'excentriques cachent sous leurs clowneries kitch une esthétique et une pensé de la radicalité dont l'influence hante les milieux artistiques depuis plus de vingt ans.
scène protéiforme
La musique des minimalistes des années 1960-70, oubliée dans les années 1980 (mis à part celle des “répétitifs”, Phil Glass et Steve Reich), a été reconnue par les milieux académiques et adoptée par la culture dj dans les années 1990 : une nouvelle source de langages musicaux pour une perception radicalement différente de l'écoulement du temps. Aujourd'hui, toute une génération de compositeurs considérés comme les classiques de l'avant-garde suscite l'enthousiasme d'un public qui a maintenant l'âge de leurs petits-enfants : Phill Niblock, Tony Conrad, La Monte Young, Julius Eastman, Eliane Radigue, Charlemagne Palestine...
C'est par le chant qu'il a soigné son bégaiement, dit Palestine au début du film. Après sa formation de chanteur de synagogue, il a étudié à New York University, Columbia University, Mannes College of Music, et au California Institute of the Arts. Dans les années 1960, il rencontre Tony Conrad, et à sa suite l'underground multi-azimuté de l'époque : Valerie Solanas (féministe radicale, auteur de SCUM Manifesto, qui tenta d'assassiner Andy Warhol en 1968), l'acteur Taylor Mead, les compositeurs La Monte Young, Morton Subotnick, Ingram Marshall, Philip Glass, le chanteur indien Pandit Pran Nath, la chorégraphe Simone Forti… Mascotte de cette scène expérimentale bouillonnante, le jeune carillonneur cultive son aura de Quasimodo pour église protestante ! Les peintres de l'expressionnisme abstrait, Barnett Newman, Josef Albers, Mark Rothko ou Clyford Still ont une influence déterminante sur sa façon de percevoir le son. En Californie il rencontre Allan Kaprow, inventeur du happening, Nam June Paik, pionnier de l'installation vidéo, Stan Brakhage et Stan Vandebeek, cinéastes expérimentaux... Il reconnaît avec gratitude la chance d'avoir reçu le meilleur de l'université tout en ayant vécu au cœur d'un mouvement artistique protéiforme qui a bouleversé sa jeunesse et marqué son époque.
minimalist/maximalist
Tout au long des années 1970, il est l'un des compositeurs-performeurs les plus actifs de la scène minimaliste américaine. Il réfute ce qualificatif appliqué à sa musique, qui selon lui est plutôt maximaliste, une forme de “masturbation agressive”, comme si l'instrument atteignait l'orgasme ! Le seul rapport avec le minimalisme, c'est qu'il se sert d'un nombre limité de notes pour créer le “Charleworld”, un univers en expansion gouverné par “The Golden Research”, (la recherche du “son d'or” qui donne son titre au film) : ça commence avec deux doigts sur un clavier et ça s'amplifie progressivement en faisceaux d'harmoniques de plus en plus denses. Le strumming est la bande-son par excellence du cinétisme new-yorkais, cette vibration métallique géante qui influencera les classiques de la post-avant-garde et la génération suivante, comme le compositeur Rhys Chatham et ses pièces ascensionnelles pour centaines de guitares électriques.
Si ses premières œuvres sont des compositions pour carillon et drones électroniques, puis pour piano, Palestine a joué et enregistré des pièces pour orgue (Schlingen-Blängen), gamelan, clavecin, harmonium. Le film se heurte à la difficulté de mettre en image des musiques abstraites dont on ne découvrira les titres qu'au générique de fin. Vocaliste dont les performances scéniques dégagent une énergie ritualisée, quasi-chamanique, Charlemagne Palestine est entré dans la légende des grands excentriques avec son jeu de piano extrêmement physique, l'instrument recouvert d'animaux en peluche, tandis que l'artiste boit de nombreux verres de cognac tout en fumant à la chaîne des cigarettes indonésiennes parfumées au clou de girofle.
Dans les années 1980, le marché de l'art tue l'improvisation scénique spontanée : il se retire de la scène musicale et se consacre aux arts plastiques. Il reprend le fil de sa carrière musicale dans les années 1990. Devant un public qui ne cesse de s'élargir, sa musique et ses installations sont présentées dans le monde entier. Les meilleures années de sa vie, dit-il avec un rire canaille et des étirements de grand félin matois, c'est maintenant ! Plus libre que jamais grâce à sa notoriété, il peut cultiver en toute quiétude l'art sacré de l'idiotie, le rejet des responsabilités, de la bonne tenue, du sérieux adulte. Conseils de spécialiste pour garder son âme d'enfant : “Rêve éveillé, divagation, fous rires, actes de beauté et d'amour produits par hasard, temps passé dans la compagnie des enfants et de ceux qui le sont restés... S'abandonner à tout ce qui stimule la créativité.” L'approche intimidée, voire compassée, choisie pour la réalisation de ce film, la mise en images conventionnelle, peinent à restituer le contexte explosif des années 1960 et dressent un portrait en décalage avec l'énergie intérieure et la fantaisie pince-sans-rire du personnage.
transe enfantine
A l'autre extrême, dans DreaMinimalist, la réalisatrice Marie Losier (auteure du bouleversant The Ballad of Genesis and Lady Jaye) livre une approche à la fois poignante et dérangeante de cette disposition à la transe enfantine, à la folie douce, qui semble être l'état permanent de Tony Conrad. Elle aussi saisit son personnage dans des moments de vie quotidienne, entre ses collections de cassettes et d'instruments à cordes, repas dans la cuisine en désordre et sortie des poubelles.
Plutôt que de s'égarer dans la chronologie complexe d'une œuvre foisonnante et d'un accès souvent difficile pour qui n'est pas amateur passionné ou érudit spécialisé, elle effleure quelques aspects de sa biographie : souvenirs de jeunesse, entre une mère marionnettiste et des cours de violon laborieux, rencontre avec le compositeur La Monte Young et le réalisateur de films expérimentaux Jack Smith. Comme à son habitude, elle fabrique des séquences bricolées façon cinéma primitif, des petites mises en scène burlesques, postsynchronisées : chahuts enfantins, déguisements et travestissements divers, objets en mouvement, danses saugrenues accompagnées de musiques de dessins animés, guitare hawaïenne, pop instrumentale éthiopienne... Au cours de l'une d'entre elles, Tony Conrad est filmé en ombre chinoise devant un rideau, sur un très beau morceau pour violon et percussions. Dans le sous-titrage, drone music est traduit improprement par musique répétitive alors qu'il s'agit plutôt de musique de sons continus (dream music devenue drone music) dont Tony Conrad compositeur fut l'un des pionniers dans les années 1960 aux côtés de La Monte Young et de Theatre of Eternal Music.
Mais ni l'improvisation en intonation juste, ni l'exploration des séries harmoniques qui sont au cœur de son œuvre musicale, ni son œuvre cinématographique ne constituent le sujet du film. Les méthodes de travail et la réflexion du réalisateur de Flicker (1965) – film stroboscopique légendaire constitué d'une succession rapide de cadres alternativement noirs et blancs, dont le spectacle peut provoquer une crise d'épilepsie chez les sujets fragiles, – se résument à une scène d’anthologie : coiffé d'une perruque et revêtu d'un pyjama rose, Tony Conrad applique une recette d'oignons en conserve à la fabrication d'un film expérimental. Dédoublé sur un même plan, il fait cuire la pellicule puis la plonge dans l'eau savonneuse et enferme le résultat improbable dans des bocaux...
Ces partis pris d'auteure, accumulations de métaphores ludiques et clowneries parfois à la limite du mauvais goût, ont de quoi dérouter le mélomane sérieux ou quiconque attendrait un portrait structuré de l'un des artistes américains les plus importants du mouvement minimaliste. Marie Losier filme ses rapports d'intimité artistique sans aucune prétention intellectuelle ou esthétique. Elle ne transforme pas les sujets de ses films en monuments de la culture universelle. A sa façon iconoclaste, puérile et désordonnée, elle cerne peut-être au plus près une forme authentique de créativité qui échappe à des productions plus ambitieuses, mais maladroites et dépourvues d'invention.
Anaïs Prosaïc (décembre 2012)