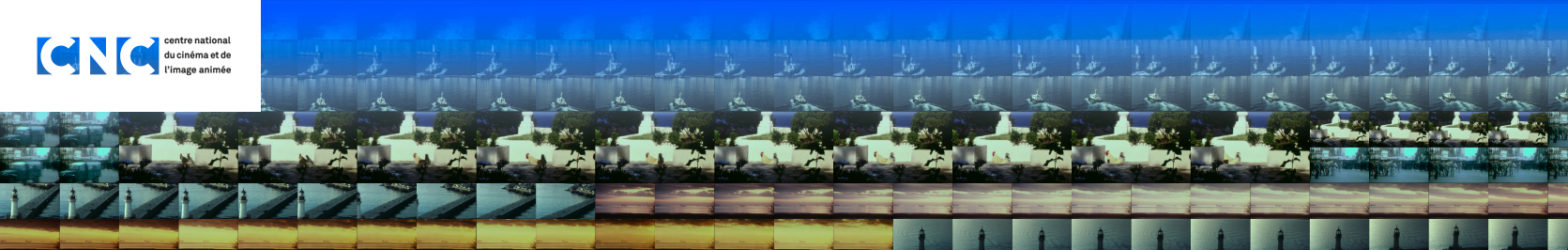Vu(e)s de Syrie

La Syrie ? Que savons-nous d’elle ? […] quelques réminiscences historiques […], quelques pages célèbres, les beaux noms de Damas, de Palmyre, de l’Euphrate […]. Mais qui pourrait tracer la physionomie politique de ce pays ? Qui expliquerait pourquoi l’on s’y bat et qui se bat ?
Joseph Kessel, En Syrie, 1922
Même s’il ressemble à un abattoir aujourd’hui […],
je sais qu’il n’existe pas de pays qui nous soit plus clément que celui-là.
Yassin Al Haj Saleh, Our Terrible Country, 2014
Dans un immeuble dévasté, vidé de ses occupants, un jeune homme prénommé Ziad prend position sur une terrasse, tandis que l’un de ses compagnons, celui qui tient la caméra peut-être, annonce : “Un membre de l’Armée syrienne libre, du bataillon des Lions de Dieu. Opération contre le sniper de la tour.” Images instables et floues, situation confuse, chaotique. “Tu vois bien la tour dans la caméra ? Tu peux voir qui est en train de tirer ?” Cavalcades, tirs croisés depuis la rue cette fois – une explosion fait virer l’image à l’orange, la fige dans un mouvement de chute tournoyant.
Apparaît alors le carton du titre, caractères blancs sur fond noir, auquel succèdent trois courtes séquences, d’autres images de guerre – même si l’on ne s’y bat plus. C’est d’abord le même combattant, blessé, assis sur un porche, qui se met lui-même en scène en donnant des consignes à un caméraman manifestement amateur (“Arrête-toi et recule. Filme-moi d’ici. – Je ne montre pas ton visage ? – Non – Où est-ce que j’appuie ? – Ça tourne”), pour faire une déclaration “au sniper, ce chien scélérat”. Vient ensuite la réalisation d’une photo de groupe, qui réunit une quarantaine d’hommes en armes – “la brigade et les bataillons de Douma, la brigade des martyrs de Douma, le bataillon des rebelles de la Goutha Est, le bataillon des Lions de Dieu” – qui, au terme d’une bataille de “quatre jours et quatre nuits”, ont remporté la victoire sur les snipers de la tour. Enfin, c’est à nouveau Ziad, marchant dans les décombres d’une rue (“Filme-le, filme-le”) et armé cette fois d’un appareil photo, la voix qui annonce : “Des photographes sous le feu”, puis ce commentaire du jeune homme : ”On est combattant et en même temps journaliste. Quand tu vas sur le front […], tu peux être amené à poser ta caméra pour utiliser ton arme.”
Dans ces scènes décousues, étranges, un peu absurdes, les protagonistes, conscients de la caméra qui les filme, affirmant sa présence, prennent la pose. Et, ne seraient les armes et les engins militaires, les bâtiments ravagés, les tirs en rafales et les explosions, le peu que nous savons de la situation actuelle de la Syrie, on pourrait presque croire qu’ils jouent : des soldats improvisés qui jouent à la guerre. Mais ce à quoi nous renvoie cette impression première, c’est à notre ignorance précisément, notre incompréhension. Et sans doute aussi notre difficulté à penser, notre refus d’accepter la réalité de ce qui nous est donné à voir : quelques minuscules fragments de ce conflit fratricide – crise, chaos, guerre civile, tragédie syrien(ne)s, quelle que soit la formule employée – dont nous entendons parler à distance, dont certaines répercussions nous touchent de près, nous atteignent parfois, mais dont, au fond, nous ne savons rien.
Hormis ce constat, il n’y a toutefois – et peut-être est-ce là justement l’une des raisons de sa force – aucune réponse à attendre d’Our terrible country (Notre terrible pays). Aucune explication, aucune résolution 1. Au contraire, dans une démarche réflexive, le film – dont le tournage s’est étendu sur plusieurs mois – met en question sa propre pertinence, il documente les conditions matérielles et morales de sa réalisation, les problèmes éthiques que soulève le fait de filmer certaines situations notamment, et la possibilité même de celle-ci, c’est-à-dire les risques de son échec en tant que projet, ou du moins ses errements, l’obligation pour ses auteurs de s’adapter constamment aux circonstances. De fait, le poids des événements, la manière dont ils affectent les parcours individuels – ce pourrait être l’un des sujets d’Our terrible country. Car de quoi s’agit-il ici ? “C’est quoi l’idée, derrière ce tournage ?” demande celui qui va s’avérer être son “sujet” principal.
La guerre est omniprésente dans Our terrible country, mais, reléguée hors champ aussitôt après ces courtes scènes d’ouverture, elle n’est plus montrée que par ses effets – matériels (paysage de désolation, champs de ruines et gravats), et avant tout humains, subjectifs. Au bout de quelques minutes, comme s’il changeait de direction après un faux départ 2, le film quitte la ligne de front pour se focaliser sur un homme qui n’est pas un combattant au sens où c’est sur le terrain des idées qu’il est engagé : l’intellectuel dissident Yassin Al Haj Saleh. Cet homme, même si le film ne le dit pas explicitement, est l’une des voix, l’une des consciences de la révolution syrienne. Opposant “historique” du régime, Yassin Al Haj Saleh a passé “seize ans et quatorze jours” dans les geôles d’Assad père : de décembre 1980, il avait alors 20 ans, jusqu’en décembre 1996 3. De cette longue détention, il a écrit qu’elle fut pour lui une “expérience de changement et d’émancipation. Une seconde enfance. On souffre et on lutte contre la souffrance. On apprend de la lutte et aussi des livres. À travers tout cela, on se libère de prisons intérieures”.4
Lorsqu’il apparaît dans Our terrible country, il vient d’arriver à Douma après deux années passées dans la clandestinité à Damas. Car, aussitôt après le soulèvement populaire de mars 2011, Yassin Al Haj Saleh a pris position pour la révolution syrienne : “Il a tout de suite été manifeste que nous étions face à un événement de grande ampleur […]. J’ai choisi de rester proche du terrain, d’être témoin de ce qui se passait et peut-être d’y participer d’une certaine manière. […] Mon rôle principal consistait à écrire au moins un article par semaine, ainsi que d’autres textes publiés dans la presse, des revues, ou bien des sites Internet. Il semble que ces écrits rencontraient un écho positif. Une des raisons était que je vivais à l’intérieur du pays. En général, quand il devenait difficile de faire la part des choses, les Syriens faisaient confiance à ceux qui étaient restés.”5 Observer la
Mais la difficulté du rôle que Yassin Al Haj Saleh s’est assigné tient au fait qu’il lui faut, pour la comprendre, “vivre la situation sur laquelle [il écrit]”, “vivre parmi les gens, comme les gens dont [il fait] partie”. Ce qui suppose en premier lieu de “rester à l’intérieur du pays”, serait-ce clandestinement, et d’essayer de combler l’écart toujours plus béant que le régime a creusé au sein de la population, entre les intellectuels et l’ensemble de la société syrienne, notamment.
Or, en accompagnant l’écrivain dans son chemin vers l’exil – trois semaines à travers le désert, au plein cœur de l’été, avec “l’avion d’Assad au-dessus de nos têtes”, de Douma à Raqqa qui vient de tomber sous le joug de Daech, puis, pendant deux mois et demi, la clandestinité encore à Raqqa, “comme alternative à l’exil”, et l’inquiétude pour Ahmad et Firas, ses deux frères enlevés par Daech, enfin l’inéluctable départ pour la Turquie – c’est précisément le renoncement à ce principe, le renoncement à un idéal, dont Our terrible country nous rend témoins. Car, pour Yassin Al Haj Saleh, l’exil est la mise en cause de la légitimité de son action. L’abandon de la lutte, d’une certaine forme de résistance en tout cas, et des amis qui la poursuivent. L’arrachement à ce pays auquel il est profondément attaché – et dont, à plus de 50 ans, privé de passeport, il n’a jamais pu sortir. La séparation, une fois de plus, et l’inquiétude pour Samira Al Khalil, son épouse et “partenaire dans la cause” 6. A quoi s’ajoutent la crainte “de ne pas comprendre l’extérieur de la Syrie, de [se] sentir idiot devant les choses” – “Je comprenais en Syrie, c’était mon pays” – et la nécessité d’inventer d’autres outils, d’autres moyens d’agir.
Le sentiment d’impuissance sinon d’échec, même relatif, auquel l’exode conduit Yassin Al Haj Saleh, ce sentiment de ”ne plus rien contrôler de sa vie et de la situation”, d’être “comme une plume portée par le vent”, est d’une autre manière partagé par Ziad Homsi – ce jeune journaliste combattant, membre de l’Armée syrienne libre, apparu dès la première image d’Our terrible country dont il cosigne, avec Mohammad Ali Atassi, la réalisation. Au fil du tournage et des épreuves traversées 7, de son compagnonnage et de l’évolution de ses relations avec Yassin Al Haj Saleh, Ziad Homsi s’impose lui aussi comme sujet du film et, avec une douceur remarquable, déchirante, comme l’est celle de son ami Yassin Al Haj Saleh, il y livre ses contradictions, la conscience du danger auquel il est exposé, ses questionnements personnels et ses doutes. Sa peur de “porter les armes pour un projet politique avec lequel il ne serait pas complètement en accord”. Son envie de vivre. Sa conviction que la révolution ne devrait pas se limiter à un quelconque projet idéologique. Mais aussi sa crainte, terrible et douloureuse, que la présence de Daech en Syrie 8 ne soit une conséquence de la révolution – qu’elle n’en soit, selon la formule de Yassin Al Haj Saleh, “une excroissance cancéreuse”. Et la part de responsabilité qu’il éprouve à cet égard.
Myriam Blœdé (février 2017)
1 L’irrésolution du film, c’est celle du conflit syrien et celle, du même coup, de la population qui le vit.
2 Aussi discret soit-il, ce changement de direction dénote une intention forte, radicale : s’opposer au sensationnalisme de l’information relative à la Syrie dans la presse internationale, une certaine pornographie de la violence qui déshumanise les victimes et permet de maintenir à distance, non seulement la réalité du conflit, mais l’humanité même des personnes qui le subissent. Cette position tout comme la définition de sa pratique de la réalisation comme du “cinéma d’urgence” (sacrifiant l’esthétique des images à la réalité et donnant la priorité aux êtres humains et aux événements) rapprochent Mohammad Ali Atassi, l’auteur d’Our terrible country, du collectif de cinéastes damascène Abou Naddara, qui, depuis avril 2011, s’emploie à documenter, à raison d’un film court par semaine au moins, la vie quotidienne et la guerre en Syrie, envisagée du point de vue de la population civile (cf. abounaddara.com et vimeo.com/user6924378).
3 Jugé onze ans et demi après son arrestation et condamné à 15 ans de prison en avril 1994, il restera incarcéré au-delà de la durée de sa peine et passera ses derniers mois de réclusion dans les pires conditions qui soient, à la prison de Palmyre, “la honte la plus indélébile de l’histoire de la Syrie”.
4 Yassin Al Haj Saleh, Récits d’une Syrie oubliée. Sortir la mémoire des prisons, trad. de l’arabe par M. Babut et N. Bontemps, Paris, Les Prairies ordinaires, 2015.
5 Ibid.
6 Le 9 décembre 2013, c’est-à-dire pendant le tournage du film, Samira Al Khalil et trois de ses compagnons, dont la militante pour les droits de l’homme, Razan Zeitouneh, ont été enlevés à Douma par des islamistes.
7 A l’automne 2013, Ziad Homsi a été enlevé et retenu pendant un mois par Daech, tandis que son père, ancien détenu politique comme Yassin Al Haj Saleh, était à nouveau arrêté par le régime.
8 Comme l’explique Yassin Al Haj Saleh, Daech, cet “autre visage du régime”, est en fait, comme l’ensemble des groupes djihadistes, protégé par le régime d’Assad qui, en les désignant comme alternative à la révolution, lui permet de s’affirmer vis-à-vis des grandes puissances étrangères comme l’unique gage de stabilité dans la région.