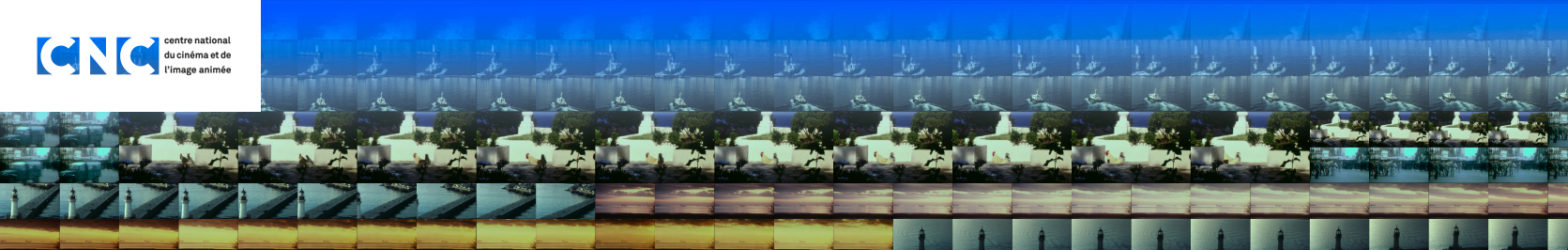Complot international

Lame de fond est le récit d’une bouffée délirante. Il s’agit d’une question extrêmement sensible. Pour autant, le film n’étouffe pas le spectateur dans un sentiment univoque, il y a même un certain humour qui affleure.
Quand j’étais au cœur du délire, je n’avais pas envie de rire, c’était très sérieux ! J’étais sûre d’être au centre d’un complot international et, même si pour mes proches c’était impossible, je ne me rendais pas compte que j’avais glissé, que j’étais tombée en dehors du réel. J’ai décidé de faire un film alors que je croyais encore à la vérité de mon délire et c’est petit à petit, en écrivant, en tournant, et bien sûr en montant le film, qu’une distance a pu être construite et qu’une forme a pu rendre cet épisode racontable. Le montage n’a pas été toujours facile, mais avec Marie-Pomme Carteret, la monteuse, nous avons souvent ri en travaillant et il doit en rester des traces dans le film.
Les films à la première personne sont parfois jugés négativement par une partie des spectateurs ou des critiques. On parle de films-thérapies. Comment avez-vous pensé aux spectateurs en réalisant Lame de fond ?
Pour moi, il y a un début de film si le cinéaste part de sa vérité. C’est à cette condition que son film peut toucher chaque spectateur au plus près de sa propre intimité. Cette idée de l’universel, de ce qui est partageable, j’espère l’avoir atteinte dans mon film.
Et il y a un temps précieux, c’est celui où l’artiste, celui qui éprouve le besoin de créer, d’effectuer un geste, n’est pas encore dans l’intention de montrer quelque chose. J’ai éprouvé régulièrement cet état. Bien sûr, j’espérais faire un film pour qu’il soit vu, mais je ne pensais pas aux spectateurs en réalisant le film, c’était avant tout cette nécessité impérieuse qui me poussait. A chaque fois que j’ai douté, renoncé à faire ce film, ou fait face à la censure, y compris l’autocensure, cette nécessité s’est imposée à moi et m’a permis de continuer.
Est-ce que la réalisation du film vous a permis de combler certains gouffres ?
Oui, j’en suis sûre. La réalisation a duré cinq ans. Pendant ces cinq années, je poursuivais un travail de psychanalyse et le film n’aurait sans doute pas pu voir le jour sans cela. Et réciproquement, le travail du film a nourri celui de l’analyse, il m’a permis d’accéder plus profondément à l’histoire familiale – peut-être pas à colmater les brèches, les gouffres sont toujours là, mais ils sont mieux éclairés.
J’ai le sentiment qu’une réparation a été opérée par le film lui-même : une réparation personnelle, privée, mais aussi une restauration du lien entre moi et les autres, moi et la société, disons le lien politique. D’ailleurs, le politique faisait partie de mon délire, délire qui fabriquait de la fiction à partir de l’opposition enfantine droite/gauche dans laquelle j’ai grandi. Mais je crois que mon film est avant tout politique dans ce qu’il pose comme parole sur un traumatisme. Et j’espère, dans le même élan que Charles Juliet qui vient de publier le septième tome de son Journal, que chaque spectateur trouvera pour lui-même quelque chose de nourrissant dans mon film.
Comment qualifiez-vous le genre cinématographique que vous avez choisi ? S’agit-il d’un documentaire, d’une autofiction, d’un journal ?
Je n’ai pas choisi de genre ! On pourrait dire que Lame de fond est un documentaire, mais c’est un film “transgenre”. Au cours de mes études, j’ai abordé le cinéma par la fiction et j’ai découvert le documentaire dans un second temps. Aujourd’hui, je m’intéresse beaucoup à la lisière entre les genres et aux formes expérimentales. Et comme la représentation du délire est complexe – le délire est vrai pour la personne qui délire, alors que pour l’entourage on est dans la fiction – la question du vrai et du faux est au cœur du film.
Les spectateurs qui voient le film se disent immédiatement que le complot international est faux – sauf ceux qui ont été comme moi atteints de paranoïa – mais ce temps, celui du présent de la crise, avec toute la complexité qu’il implique, a guidé l’écriture et la réalisation. La question de la construction d’un souvenir devait aussi être constitutive du film : c’est la question de la mémoire, à partir de laquelle on peut partager quelque chose de réel, sur le mode du “Il était une fois”. C’est donc à partir de ces coordonnées, ajoutées au fait que j’ai vraiment traversé l’histoire que je raconte, que la forme du film s’est dessinée.
“Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas” : c’est une phrase de Lacan.
La question de la vérité, c’est peut-être une question de langage : est-ce qu’on a les mots pour la dire ? Je pense, par l’expérience que j’ai faite, que l’on peut avoir accès à une certaine vérité, de l’ordre de l’inconscient collectif, et qui est aussi physique, de l’ordre de la mémoire du corps. Et on n’a pas forcément le langage verbal, les mots, pour l’exprimer. Par contre, on peut avoir le cinéma.
C’est vraiment la réalisation du film, notamment au moment du montage et de l’enregistrement de la voix, qui m’a révélé beaucoup. C’est comme si j’avais eu toutes les pièces d’un puzzle et que le montage m’avait permis de les assembler. J’avais écrit une voix quatre fois plus longue que n’est la voix définitive du film et Marie-Pomme Carteret me disait souvent “ça, tu n’as pas besoin de le dire : regarde”. Et en effet, petit à petit le film prenait corps, par le montage des images et des sons (nous avons fait le montage son et le montage image en même temps). La question de la vérité ne se pose vraiment pas de la même manière, s’agissant d’un récit écrit, oral, ou bien d’un récit cinématographique.
Quel rôle joue l’image dans Lame de fond ?
J’ai dû l’apprivoiser, la caméra ! Je me rends compte que j’ai filmé selon une relation assez physique à la caméra et à ce que j’étais en train de vivre au moment où je tournais. Par exemple, j’avais écrit dans le scénario qu’il y aurait un moment filmé au milieu d’une foule oppressante dans une gare parisienne. Quand j’ai voulu tourner ce que j’avais imaginé pendant longtemps, je n’y arrivais pas. J’évitais consciencieusement les foules, ou elles me mettaient suffisamment mal à l’aise pour que je n’arrive pas à filmer. Je ne pouvais être que déçue par les images enregistrées.
Finalement, je suis retournée dans une gare, en me libérant de toute intention. J’y suis restée longtemps avant de filmer quoi que ce soit, à déambuler, repérer et sentir. Puis, de manière très intuitive, j’ai filmé comme je le sentais. Je crois que c’est quand je suis au plus juste par rapport à une impression ou une situation que mes images sont les plus réussies. Lame de fond est un film de perceptions, comme si la caméra devenait une peau, un corps sensible. Et c’est la même chose pour le son.
Je pratique la photo et j’ai l’habitude de faire de la prise de son seul : images et sons, à l’origine, ne sont pas des éléments synchrones. Finalement le travail de désynchronisation coïncide bien avec l’idée du délire, car dans mon délire, j’avais des flashes visuels, sonores, qui étaient eux-mêmes séparés. Peut-être que la désynchronisation permet de redoubler l’espace du hors champ. C’est une des questions essentielles de mon film, celle du hors champ, de l’espace imaginaire possible autour d’une image, autour d’un son.
Ce sera l’enjeu d’un prochain film : faire l’expérience du tournage synchrone et… filmer quelqu’un qui parle !
Allez-vous produire vos prochains films vous-même, comme vous l’avez fait pour Lame de fond ?
Je n’ai pas rencontré le bon producteur pour ce film. Ou alors il n’existe pas. Car il s’agit bien d’un choix réciproque, n’est-ce pas ? J’ai donc produit moi-même Lame de fond. Seul le Conseil Régional d’Aquitaine a soutenu le projet, qui malgré cela est resté vraiment sous-financé.
Je ne produirai pas mes prochains films. J’ai été trop isolée dans le travail et j’ai besoin et envie, aujourd’hui, de travailler en équipe et en confiance. Je cherche une tribu ! Je crois que mon expérience de la production m’a donné à voir ce que pouvait être ce métier, et j’espère être devenue une réalisatrice-interlocutrice consciente des enjeux, des difficultés, des équilibres à trouver pour un producteur. Je rêve de pouvoir être accompagnée tout en continuant à garder ma liberté et mon exigence.
Propos recueillis par Olivier Daunizeau, janvier 2014 (dans le cadre de l'accompagnement à la diffusion culturelle d'ECLA-Aquitaine).
A voir