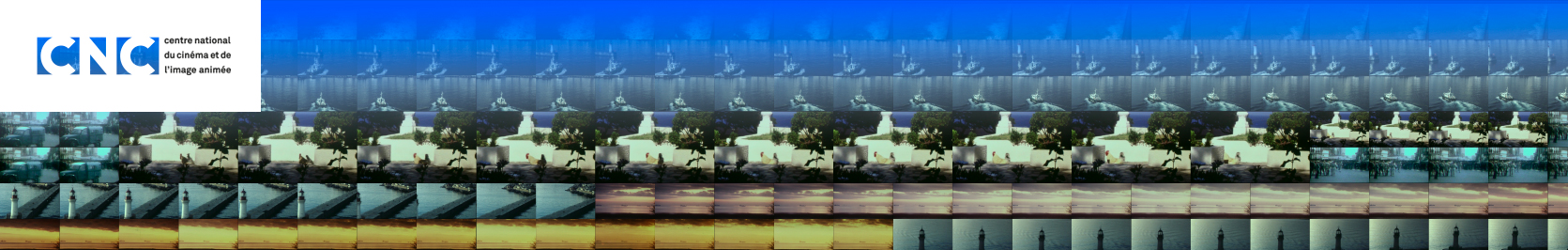Entrer dans la lumière

C’est à l’invitation de votre sœur, la danseuse et pédagogue Nawal Aït Benalla-Lagraa, et de son mari, le chorégraphe Abou Lagraa, que vous êtes entré dans le milieu de la danse. Ils vous ont convié à réaliser une série de photographies lors des auditions en vue de la constitution de la première compagnie de danse contemporaine en Algérie. Comment s’est fait ce passage de la photographie à la cinématographie ?
Ils m'ont proposé de réaliser des photographies et un film court qui s'intègrerait à la pièce pour la première de Nya en Algérie. Ils avaient mis sur pied un projet de formation et de création qu'ils avaient intitulé Pont culturel méditerranéen pour développer les échanges avec des danseurs d'Algérie et, dans un second temps, plus largement du Maghreb. Je suis arrivé sur le projet au printemps 2010, après les auditions et quelques mois de formation des danseurs.
Vous avez réalisé vous-même l’image, le son et le montage du film. Pourriez-vous nous expliquer la façon dont vous avez procédé ?
Au départ, ce n'est pas réellement un choix mais une nécessité. Comme j'étais seul, j'ai dû me débrouiller. C'était en 2010 et je travaillais avec une caméra-appareil photo qui venait d’apparaître sur le marché. C'est un outil très compact, que j'utilisais avec des optiques fixes. Petit à petit, cette solitude dans le travail a nécessité un peu d'inventivité technique pour contourner ce qui pouvait poser problème. L'acoustique des studios de danse était difficile à maîtriser car il y avait beaucoup de réverbération. Cela a même influencé l'esthétique du film puisque je devais être proche des gens que je filmais pour en capter le son. Selon les situations, c'était plus ou moins acrobatique. Ensuite, comme il est difficile de trouver des financements lorsqu'un film est déjà tourné, j'ai commencé à monter moi-même quand j'en avais le temps, après avoir laissé reposer les images pendant une année. Et ce n'est qu'à ce stade, au montage pratiquement terminé deux ans après avoir tourné, que j'ai obtenu des soutiens financiers qui m'ont permis d'engager des collaborateurs pour finir la post-production et le présenter au Doha Tribeca Film Festival. Il me faut tout de même préciser que, sur la fin du film, j'ai aussi été accompagné de près par les cinéastes Pierre-Yves Cruaud et Nora Martirosyan avec qui je travaille depuis.
Après les auditions, les danseurs ont donc effectué un stage de formation avant de commencer les répétitions pour le spectacle Nya, présenté en première mondiale en septembre 2010 à Alger. Combien de temps avez-vous passé auprès des danseurs ?
En effet, pendant plusieurs mois les danseurs ont bénéficié de cette formation, mais elle s’est poursuivie aussi pendant la phase de création et donc pendant le tournage. Ma sœur Nawal leur donnait des cours le matin et les préparait physiquement au travail avec Abou. Le film montre aussi cette phase de la journée de travail, sorte de mise en condition au moyen d'exercices de respiration, de yoga, d'assouplissement, avant de travailler plus précisément certaines parties du corps. J'ai fait plusieurs courts séjours auprès des danseurs en Algérie et en France, où ils ont aussi travaillé, qui représentent un mois et demi en tout.
Votre caméra serre au plus près les corps et les visages des protagonistes, leurs mouvements, vous participez de façon très directe aux répétitions. Et pourtant, vous n’intervenez jamais dans le film.
Il fallait composer avec les contraintes techniques. En restant à distance, je perdais les sensations corporelles véhiculées par le son. Les premiers temps, il m’a fallu trouver ma place dans cette équipe en train de se constituer. Parfois, porté aussi par l'énergie du groupe, je me jetais à l'eau, je tentais des choses pour voir comment je pouvais bouger avec eux sans déranger le cours de leur travail. Comme je voyais très souvent les danseurs en nage (nous étions en été), j'ai eu la sensation qu'il me fallait aussi m'impliquer physiquement dans la prise de vue et de son, sentir et donner à voir cet investissement physique, très spécifique à la danse d'Abou Lagraa et servie par des danseurs surprenants d'engagement. En un sens, il fallait être à la hauteur de leur implication. Au fil du temps, à force d'essayer de bouger avec la caméra, je me suis senti de plus en plus à l'aise, j’ai trouvé mes repères. Cela s'est fait de façon très instinctive.
Vous avez réalisé une partie de la bande son de la chorégraphie Nya. Etait-ce votre première expérience ?
Depuis une fenêtre à Alger, j'avais enregistré des ambiances ; nous y étions pendant la coupe du monde de football et la matière sonore était extrêmement riche ! J'ai aussi enregistré d’autres types de sons, des bruits de rue, de mobylette, de pas, et Abou a voulu commencer la pièce avec ces sons. Ce n'est donc pas un travail spécifique pour la bande son de Nya, mais l'utilisation d'une matière sonore qui existait dans le contexte de l’espace scénique.
En effet, à maintes reprises dans votre film, le bruit de la ville s’invite dans la salle de répétition.
Pour signifier la ville dans laquelle prenait place cette histoire, j'ai privilégié les images sonores. Et durant le montage, j'ai enlevé les quelques plans de la ville d'Alger que j’avais tournés ; je voulais que la ville entre dans le film par le son. Cela me paraissait créer une image plus ouverte, plus riche, plus englobante. Cela permettait aussi d'intérioriser le propos, de ne pas relâcher cette forme de concentration-tension croissante qui montait à l'approche de la première. Ces ambiances sonores dessinent le hors-champ : derrière les murs et les fenêtres des studios de répétition, il y a une vie qui continue comme si de rien n'était.
Les protagonistes de votre film ne s’adressent jamais à la caméra sinon par le biais du langage corporel. Etait-ce un choix de votre part ?
Les danseurs ne m'ont rien imposé et je n'ai pas désiré interférer en leur demandant de dire ou faire quoi que ce soit devant la caméra. Cela m'aurait semblé déplacé et inutile. Le principe était bien sûr de ne pas déranger, de ne pas les sortir d'eux-mêmes, de leur concentration. Etre là, chacun à sa manière. Faire autrement reviendrait à ne pas faire confiance à la danse.
Votre documentaire présente de jeunes danseurs autodidactes qui ne s’étaient jamais produits sur scène, en train de devenir des artistes à part entière. Sur votre site, vous écrivez : “Les jeunes danseurs entrent dans la lumière de la scène comme on entre dans le monde.” Pourtant, cette “lumière de la scène”, le spectateur ne l’entrevoit que du côté des coulisses. Pour cette première représentation qui clôt le film, la caméra reste dans les pendrillons auprès des danseurs et capte leurs émotions avant qu’ils “entrent dans le monde”.
C'est peut-être un peu grandiloquent comme formule… mais le choix de rester aux côtés des danseurs dans les coulisses, le soir de la première, donne à voir la pièce comme à travers leurs yeux : une vision forcément parcellaire, presque amnésique, qui nous éloigne des conventions du spectacle et des enjeux initiaux de narration. C'est une autre forme de chorégraphie qui surgit en adoptant ce point de vue car il nous place entre la lumière de la scène (l’espace vu par les spectateurs) et le noir des coulisses (lieu de fabrique du spectacle). Cette mise en scène du regard relève d’une expérience spécifiquement cinématographique et se distingue a contrario de la perception classique du spectacle vivant. Mais, là encore, cela s'est fait sans trop de préméditation. Je pouvais rester aux côtés des danseurs sans les déranger, et il y avait cette lumière rasante qui sculptait les corps sur le fond noir des rideaux et me rappelait la peinture de Zurbarán ou du Caravage.
Abou Lagraa s’adresse aux danseurs en leur disant : “L’Algérie est indépendante depuis 1962, est-ce que vous, vous êtes indépendants ?” Au-delà de la danse et de son apprentissage, votre film interroge-t-il la question des libertés en Algérie ?
Il est certain que la danse contemporaine questionne la représentation du corps et, au Maghreb en particulier, l'affirmation de la liberté individuelle qu’elle implique. Il a fallu de la volonté et de la ténacité à Abou et Nawal pour mettre sur pied ce Pont culturel méditerranéen dans un environnement où il y avait tout à faire. Ils sont sortis d'une zone de confort pour tenter une expérience pleine de sens, qui les engageait directement tout comme les danseurs qui s’y sont investis. Le film ne fait que mettre en forme cet engagement dont j'étais témoin. Mais il montre aussi des jeunes gens désireux de pratiquer leur art en toute liberté, tout en se souciant de la réaction de leur famille et de leur entourage. Au vu de l’accueil qu'a connu Nya trois soirs durant en remplissant le Théâtre national d'Alger, on peut en déduire que cette soif de liberté et de culture est très partagée.
Comment le film a-t-il été reçu par les danseurs ?
Ils n'ont pu voir le film que longtemps après. Ils étaient en tournée en Europe et ailleurs, et j'aimais l'idée que le premier visionnage soit collectif. Finalement, cela s'est fait à la Maison de la danse de Lyon pendant qu'ils travaillaient à une nouvelle pièce d’Abou Lagraa et sa compagnie La Baraka. Avec le temps de la fabrique du film, les images qu'ils voyaient avaient déjà trois ans. Ils se sont revus à leurs débuts. Je crois que c'est ce qui les a le plus touchés : la conscience du chemin parcouru en si peu de temps.
Avez-vous un nouveau projet sur la danse ?
Nawal prépare sa première pièce en tant que chorégraphe dans un projet plus global, toujours porté par la compagnie La Baraka. Ce sera une nouvelle expérience que je vais suivre de près.
Propos recueillis par Irina Severin, décembre 2014.
à voir : slab-net.com