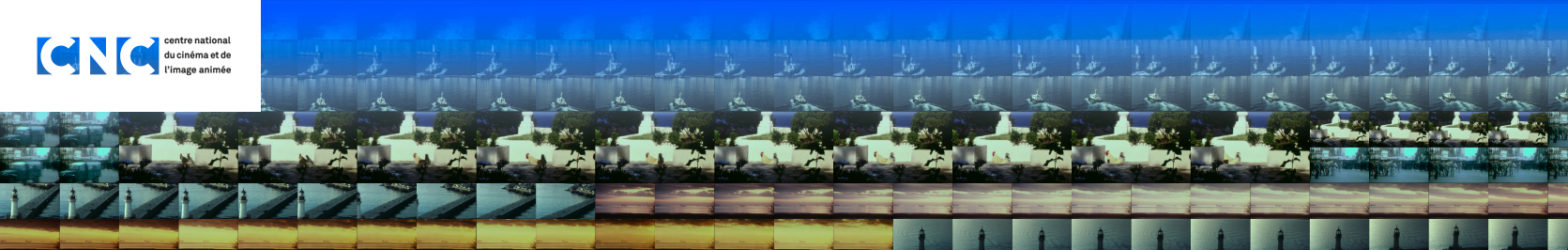Nocturne indien

Derrière le comptoir d’une échoppe de street food, un homme s’arrête de confectionner des paans appétissants pour feuilleter l’imprimé de grand format qu’on lui tend. Une voix explique en gujarati que ce journal contient vingt-cinq histoires de fantômes recueillies lors de repérages pour un film documentaire avant de demander si, pour sa part, il aurait une expérience similaire à partager. Du tandem franco-indien à l’œuvre derrière la caméra, Léandre Bernard-Brunel et Abishek Mistry, alter ego rencontré lors d’une année d’études à l’Ecole des Beaux-Arts de Vadodara, on n’aperçoit que deux mains, apparaissant bord cadre pour saisir les paans offerts. Mais le commerçant n’a pas le temps de raconter des histoires. Avec une extrême rapidité, il poursuit sa tâche : saupoudrer les feuilles de betel de cerises, d’épices et de tabac avant de les rouler pour en faire une friandise aux proportions parfaites.
La première scène de Vetal Nagri expose ce qui a failli être l’impasse du film : il est plus difficile de se faire offrir un récit qu’un paan, même aidé d’un objet intercesseur, si inspirant soit-il. Encore faut-il être là au moment opportun. Quand on l’interroge sur la genèse de ce film, Léandre Bernard-Brunel évoque deux désirs à première vue contradictoires : celui d’avoir accès à l’intimité indienne et celui de filmer la rue. La journée, celle-ci est parcourue de trop d’agitation, chacun s’y affaire sans répit. Il choisit donc de filmer la nuit, quand l’échange devient possible. L’intuition de départ d’accrocher le réel par le biais des représentations du fantastique, pour paradoxale qu’elle soit, s’avère pertinente en Inde où les manifestations d’esprits imprègnent profondément la culture populaire, et alimentent la machine narrative des séries télévisées, des feuilletons radiophoniques et du cinéma.
A Vadodara comme ailleurs, tout le monde a une histoire de revenant à raconter. Comme Goopy et Bagha, héros du film éponyme de Satyajit Ray (1968), vont dans la forêt rencontrer le roi des fantômes, Léandre et Abishek - petit-fils d’un authentique chasseur de fantômes - sillonnent en scooter le quartier de Ladwada, munis de ce journal chargé d’encre et d’histoires qui se révèle finalement d’une grande efficacité dramaturgique. A l’heure où l’on baisse les rideaux de fer et où l’on s’attarde sur les seuils, ils interrogent l’épicier, le garagiste, le marchand de couleurs ou de farine et toute une famille de forgerons, chacun se prêtant au jeu d’apporter sa pierre à la collection d’histoires qui donnent la chair de poule.
Depuis la lanterne magique de l’astronome Christiaan Huygens - dont la première plaque donnait à voir un squelette animé, inspiré d’une Danse macabre d’Hans Holbein - c’est peu dire que le cinéma entretient avec les fantômes un lien privilégié. Historien de formation, passionné par la Révolution française, Bernard-Brunel n’ignore pas non plus qu’à la fin du XVIIIe siècle on appelait lanterne de peur ce procédé encore disruptif qui faisait apparaître des spectres sous le regard horrifié des badauds. Mais s’il vient chercher le spectateur à l’endroit de sa relation aux esprits, Bernard-Brunel ne cherche pas à susciter l’effroi. Plutôt, et pour commencer, à dresser une sorte d’inventaire de (ce) qui nous possède. Une femme trahie ? Lubrique ? Un disparu dont la colère est inapaisée ? Et en matière d’autorité ès-chasse aux fantômes, le film semble hésiter entre plusieurs tutelles. Qui saura le mieux défaire l’emprise ? L’intervieweur autochtone – Abishek Mistry a sûrement hérité des dons de son grand-père ─ ou le filmeur européen, celui qui n’y croit pas, le sceptique ? A moins que ce ne soit cette jeune femme en sari qui avance à pas lents, brandissant devant son visage un kakemono transparent sur lequel est imprimé un tableau de Goya (Deux Vieux) ? Est-elle celle qui peut libérer les corps possédés ou au contraire la plus séduisante des chudails ? La séquence revient à plusieurs reprises, comme un rêve récurrent. La mise en scène crée une surimpression très onirique entre son visage et les figures goyesques. Deux Vieux appartient au cycle des Pinturas negras, peintes sur les murs de la Maison dite du Sourd que Goya achète à la fin de sa vie. On y voit un personnage de moine au visage monstrueux crier dans l’oreille d’un vieillard appuyé sur sa canne. Une représentation qui rappelle étrangement celle de la légende du roi Vikram lesté du fantôme Vetala agrippé sur son dos, qui donne son titre au film.
Mais alors qui est le sourd dans cette histoire ? Est-ce ce jeune réalisateur français qui maîtrise mal le gujarati et doit s’en remettre à son ami pour mener les entretiens ? Et ne découvrira leur contenu qu’à Paris au moment de leur traduction ? Ne sommes-nous pas aussi sourds à un monde magique qu’ici nous considérons au mieux comme folklorique ? Avec Vetal Nagri, Bernard-Brunel met à l’épreuve sa propre rationalité et sa réticence à l’endroit du bizarre. Tout en affirmant que le cinéma est un régime de croyance comme un autre, ou plus précisément qui en a supplanté d’autres. Dans un geste à la fois lyrique et raisonné, il compose avec ces très beaux travellings nocturnes un espace de méditation sur ce qui entre en nous, ce par quoi nous nous laissons posséder, que nous cherchons à expulser ensuite et par quels moyens. Au cœur du film se déploient les imaginaires sexuels des hommes de Vadodara qui conjuguent le plus souvent ces scénarios de possession au féminin : ainsi surgissent la figure d’une revenante érotomane, ou celle dont l’intrusion condamne sa malheureuse victime à l’impuissance ou à un changement de sexe. La réitération troublante, dans de nombreux documentaires sortis la même année que Vetal Nagri 1, du motif de l’effraction du Moi par une puissance étrangère révèle l’actualité de cette angoisse. Comme si l’époque, menaçant la sécurité de certaines enveloppes, avait tendance à prendre d’assaut nos frontières psychiques.
Mais cette question de la possession/dépossession est aussi pour le cinéaste l’occasion de révéler, outre ce qui entre par effraction – et c’est là sans doute la plus belle part du film ─ ce qui circule, ce qui passe, pas seulement de main en main comme le journal, mais d’imaginaire à imaginaire, d’un espace culturel à un autre. De la même façon qu’il met en scène cette jeune femme dont le visage est voilé du tableau de Goya comme il le serait d’un dupatta, Bernard-Brunel fait correspondre de subtils réseaux de représentations culturelles. En effet, ces revenants gujaratis rappellent nos Dames blanches, apparaissant au détour d’un virage sur une route de montagne, ou la Llorona mexicaine, toujours voilée elle aussi. Et la recherche, plan de la ville en main, de la Goya Gate ─ réellement dénommée ainsi à Vadodara – que le film met en scène est surtout celle de cette porte magique qui relierait l’Espagne au Gujarat, la petite communauté peinte par Goya et celle des échoppes mitoyennes de Vadodara.
Entre les deux, Bernard-Brunel fait circuler des invariants ─ le matriarcat, le moment de la sieste ou un lacis de ruelles sombres – qui rapprochent l’espace méditerranéen de celui du sous-continent indien. Et qui, passant de nous à eux, font communauté. Comme ces commerçants hindous évoquant des djinns, ou ces mécaniciens musulmans des fantômes hindous dans leurs confidences 2. Mais au-delà de ces motifs particuliers, ce que cherche Léandre Bernard Brunel, c’est le pouvoir du récit, le seul sans doute capable de nous relier par-delà les continents, les religions, les classes sociales. Parce que la fiction nous possède, tous.
Hasard ou coïncidence, les contes du roi Vikram et du vampire Vetala ont été traduits pour la première fois en anglais par Sir Richard Burton, également le premier traducteur occidental des Mille et Une Nuits à la fin du XIXe siècle. Par ce premier d’une longue série de raccourcis interculturels, Bernard-Brunel se prend à rêver de filmer non pas les mille et une nuits du Gujarat mais une seule nuit fictive, reconstituée, au cours de laquelle des hommes et des femmes parleraient de fantômes. Dans Spectres de Marx, Jacques Derrida cite la célèbre didascalie d’Hamlet : “Enter the Ghost, Exit the Ghost, Re-enter the Ghost.” Revitalisant l'injonction shakespearienne, Léandre Bernard-Brunel convoque avec succès les fantômes indiens pour l’épauler dans sa tâche de faire naître du récit, et du lien, et, en plaçant la fiction au cœur de sa démarche documentaire, il réussit à faire advenir du cinéma.
Céline Leclère, octobre 2018.
1 L’année où Vetal Nagri était en compétition au Cinéma du Réel de nombreux films se saisissaient de cette thématique de la possession (Duelo d’Alejandro Alonso, Prends seigneur, prends, de Cédric Dupire et Gaspard Kuentz) et ce juste après le documentaire de Joris Lachaise, Ce qu’il reste de la folie, sorti en salles en 2016.
2 Vadodara, 400 km au nord de Bombay, est la 3e ville du Gujarat, l’état de Narendra Modi, premier ministre et leader du BJP, le parti nationaliste hindou, et les violences entre les deux communautés y sont fréquentes.