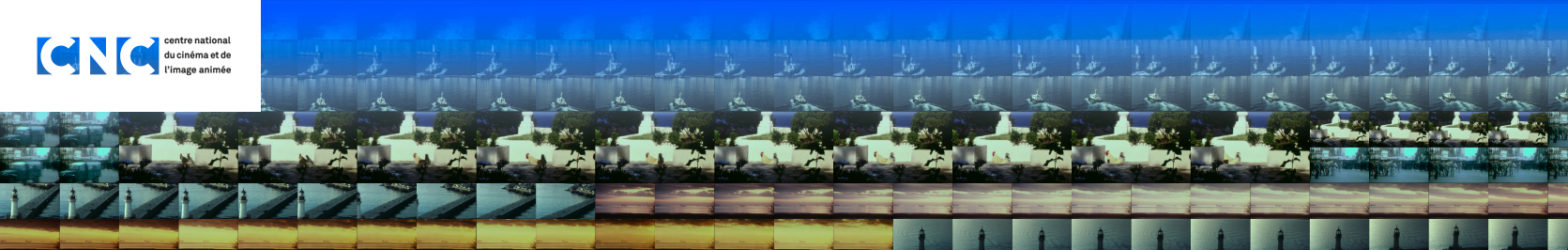Rapt à Paris

Comment est né le projet du film ?
Depuis mon adolescence, j’ai toujours eu envie de raconter cette histoire. Après les Beaux-Arts, j’ai fait une école d’audiovisuel, l’ESAV de Toulouse, et à partir de ce moment-là, j’ai pensé à en faire un film. Le processus de gestation a été long, d’autant que c’était mon premier film. J’avais une productrice, Chantal Teissier, qui soutenait le projet mais, compte tenu du sujet, elle ne pensait pas possible de le présenter à une chaîne de télévision. Ce qui a vraiment déclenché la production du film, c’est l’obtention de la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam. Elle m’a rassuré sur la qualité du projet et donné confiance en moi. J’ai pu immédiatement réaliser le tournage avec mon père qui était déjà très malade. Ces images, où on le voit allongé avec sa carabine, ont été tournées deux ans avant le reste du film. J’ai pu produire ainsi un trailer qui a permis de trouver d’autres financements.
L’histoire de l’enlèvement, vous en aviez entendu parler depuis très longtemps ?
En fait, je n’ai pas appris cette histoire par mes parents mais lorsque j’avais quinze ans par la bande dessinée Rapto en Paris. J’étais un passionné de BD et celle-là, j’étais le seul à en posséder une copie, mes copains ne la connaissaient pas. La version originale est aujourd’hui introuvable (ou alors dans les archives de quelques anarchistes) mais elle a été rééditée en sérigraphie et elle est maintenant accessible sur Internet. Il s’agit d’un recueil de textes et de dessins publié en 1976 (seulement deux ans après les événements) pour expliquer les actions du groupe G.A.R.I.. On y trouve un peu de BD et surtout un ensemble de tracts et de textes précisant les motivations et les circonstances des actions, afin de rectifier les versions développées par la police et les journaux. Il existe une autre BD, plus développée, Dossier G.A.R.I., qui a été réalisée à la prison de la Santé par les prévenus en attente de jugement, et qu’on voit dans le film. Mais c’est la première, Rapto en Paris, détournement d’une célèbre BD franquiste, qui a servi de point de départ au film. Il y avait à l’époque toute une culture du détournement, surtout pratiquée par les situationnistes, et le langage de la BD était une manière de revendiquer les actes sans se prendre trop au sérieux.
La première séquence du film est traitée en cinéma d’animation. Aviez-vous l’intention de poursuivre tout le film avec une esthétique inspirée de la BD ?
En fait cette séquence d’animation permettait de monter les témoignages de personnes qui ne voulaient pas apparaître à l’écran. Elle ouvrait un récit d’action et c’est comme cela, avec Fabien [Daguerre], le monteur, que nous avions envie de raconter cette histoire. Je n’avais pas envie de faire un film trop sérieux, trop chargé d’informations et de références historiques.
Avez-vous envisagé de traiter ce récit avec les moyens de la fiction ?
Non, je n’avais aucune envie de faire intervenir des comédiens pour entrer dans du docu-fiction, mais je voulais que le rythme soit celui d’un thriller. Ce qui m’intéressait, c’était de parler de gens comme tout le monde, qui avaient fictionné leurs vies. Si je faisais jouer des comédiens, ç’aurait été au détriment des personnages réels. Ce problème ne se pose pas avec l’animation car le personnage dessiné ne fait aucune concurrence au personnage de la réalité. Avec des acteurs – je pense à Yves Montand dans La guerre est finie [d’Alain Resnais, 1966] – il y aurait compétition entre le héros de la fiction et le personnage réel et l’un finirait par voler la vedette à l’autre.
En faisant raconter cette histoire à plus de trente ans de distance par ceux qui l’ont vécue, vouliez-vous montrer ce qu’ils sont devenus et mettre une certaine distance critique ?
Non, ils avaient le désir de raconter les faits au présent, sans regard critique rétrospectif, et moi non plus, le recul de l’histoire ne m’intéressait pas. Je voulais filmer ce qu’ils avaient ressenti à ce moment-là, les moments de joie lorsque l’action réussit, les moments d’angoisse lorsque les événements tournent mal. L’essentiel pour les jeunes militants révolutionnaires qu’ils étaient alors était de ne pas rester sans rien faire alors que des résistants antifranquistes risquaient la peine de mort en Espagne. Je pense que le film reflète bien la mentalité de cette époque. Mais certaines personnes de cette génération m’ont reproché de ne pas avoir assez introduit de dimension réflexive, regrettant que les protagonistes ne portent pas de jugement critique sur leurs actions d’alors. Elles voulaient sans doute relancer le débat qui avait eu lieu à cette époque entre d’un côté les anarchistes, et de l’autre, ceux qui tout en approuvant les objectifs critiquaient les méthodes. Ce débat m’a paru trop décalé par rapport à aujourd’hui. De toute façon, je n’aurais pas été la bonne personne pour faire un film d’analyse sur l’après-68.
Ce film donc, vous l’avez fait avec le soutien des principaux participants à l’enlèvement. Y en a-t-il qui ont refusé d’en être ?
Certains ont donné leur voix mais pas leur image ; certains comme la compagne d’Octavio, malgré mon insistance, n’ont pas voulu donner leur témoignage. Même ma mère (Hibou dans le film) était au début très réticente. Il a fallu la convaincre car sans elle, le film était impossible.
Sans elle et sans ce plat qu’elle prépare longuement avec Raymond, le film perdrait beaucoup de saveur !
C’est une paella au lapin !
A côté des personnages, le film recourt à beaucoup d’archives. Quel rôle jouent-elles ?
J’ai été très content de retrouver à l’INA l’archive télévisuelle du concierge de l’immeuble de Neuilly qui décrit les suspects de l’enlèvement, ou cette séquence avec les policiers de l’antigang dans leur commissariat. Elles restituent ce que fut la couverture médiatique du rapt. L’archive du porte-parole de la famille du banquier Suarez est aussi très précieuse car elle permet de passer du dedans au dehors.
En revanche sur la campagne d’attentats menée en Belgique au cours de l’été 1974 par Jean-Marc Rouillan et quelques autres, je n’ai retrouvé que des articles de presse écrite. Du coup, j’ai monté une séquence assez brève sur ces événements, mais bien rythmée. Alors que le film était quasiment achevé, je me suis rendu compte qu’on risquait de ne pas en comprendre les enjeux. Il ne nous restait qu’une semaine ou deux de montage quand on s’est dit qu’il fallait insérer un passage sur Franco. Comment résumer trente ans de franquisme en trois minutes de film ? C’était une gageure. Je ne voulais pas m’étendre davantage parce que ce n’était pas le sujet du film. J’ai pris l’option d’un texte simple, en voix off, placé au début, qui fait de Franco le méchant de l’histoire. Dans les films d’aventures, il faut un méchant. Là, c’est Franco, c’est lapidaire, même naïf, mais j’assume.
Comment le film a-t-il été reçu en France et en Espagne ? Ne vous a-t-on pas reproché une certaine complaisance vis-à-vis du terrorisme ?
Je ne crois pas être complaisant, ou alors un tout petit peu. Les spectateurs qui ne sont pas des militants le prennent comme un film d’aventures, et lorsqu’ils reconnaissent des lieux ou des personnes, ça les touche d’autant plus. A Paris, au festival Bobines sociales, j’ai eu quelques réactions de la part de gens qui, à l’époque, désapprouvaient ces formes d’action. La majeure partie du public réagit de façon plus directe, rigole quand il y a des blagues ou s’attriste quand il y a échec. Les jeunes m’ont dit que le film donnait envie de s’engager dans l’action et l’aventure. La question de l’illégalisme, on ne peut pas la trancher si simplement. Ceux qui en 1940-1945 ont été traités de terroristes, ont reçu par la suite des médailles de la Résistance. Comme le montre très bien le film de Mosco, Ni travail, ni famille, ni patrie – Journal d’une brigade FTP-MOÏ [1993].
Cette référence à la Résistance était-elle importante dans les années 1970 ?
Pour les anciens de 68, la référence historique à la Résistance française comptait beaucoup. Mon père, qui était l’un des plus âgés, avait déjà lui-même connu la clandestinité pendant la guerre d’Algérie en étant insoumis. Pour les militants espagnols de la génération précédente, comme Octavio, plongés dès l’enfance dans la révolution puis la résistance antifranquiste, c’était différent : ils avaient toujours connu la clandestinité. En 1974, le qualificatif de terroriste apparaît assez peu dans la presse, c’est plutôt un vocabulaire d’aujourd’hui. A l’époque, ces militants étaient assez populaires et les sanctions d’ailleurs n’ont pas été lourdes. Ils ont purgé entre un an et demi et deux ans de préventive et, en 1981, tous ont été acquittés. Si Jean-Marc Rouillan est retourné plus tard en prison, c’est pour d’autres faits dont il n’a pas le droit de parler puisqu’il est actuellement en liberté conditionnelle.
On aurait certainement aimé savoir ce que les uns et les autres sont devenus par la suite.
Ils sont tous restés très engagés, mais ils ont pris des chemins différents et n’ont pas toujours été d’accord sur certaines actions ou certaines pratiques.
Vous avez filmé votre père malade peu avant sa mort et avez monté ces images après son décès. Etait-ce pour vous une manière d’hommage posthume, une manière d’assumer l’héritage ?
Je n’ai pas voulu m’étendre dans le film sur la maladie de mon père. J’ai voulu raconter cette histoire telle que je l’avais entendue dans mon adolescence. Lorsque j’avais quinze ans et que mon père me la racontait, avec cet humour caustique qui transparaît bien dans le film, il était alors en pleine forme. Mes parents vivaient ensemble au sein d’une communauté où j’ai grandi. Je viens de réaliser un court métrage sur mon père (en bonus dans l’édition commerciale du DVD), La Part des pirates, à partir de séquences qui ne pouvaient pas entrer dans ¡G.A.R.I !. Il permet de mieux comprendre ce personnage un peu grognon, un peu nerveux, et comment, à la suite de cet enlèvement, il s’est retrouvé à la prison de la Santé. Mais avec ¡G.A.R.I. !, je tenais à laisser un peu de côté "l'histoire familiale" pour donner la parole aux protagonistes d'une aventure qui a contribué à l’écriture de l'histoire d'un peuple, le peuple des dissidents de l'après-68. C'est d'ailleurs cette envie qui m'a permis de trouver mon propre personnage. Fabien Daguerre et Philipe Aussel, mon producteur (Le-loKal), m'ont persuadé d'enregistrer une voix off pour qu'on comprenne quand même quelque chose à cette histoire. J'ai revu Little Big Man et je me suis inspiré du personnage du journaliste un peu niais qui pose des questions à un vieil Indien sur son histoire et celle de son peuple. Je voulais une voix off qui ne soit ni objective, ni dictant au spectateur ce qu'il doit penser. Nous voulions (c'est quand même un vrai travail d'équipe) une voix off qui nourrisse un personnage, qui soit engagée dans le film pas dans la propagande.
Votre prochain projet ?
Je voudrais raconter l’histoire depuis les années 1980 de mobilisations et d’actions qui ont compté et dont les mouvements actuels, à Sivens, à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs sont la continuation. Car il est faux de présenter les jeunes activistes d’aujourd’hui comme des énergumènes sans mémoire historique et sans culture politique, qui en plus feraient le jeu de l’extrême-droite. Je voudrais repartir du camp du Larzac, de la centrale nucléaire de Golfech, de ces actions qui ont conduit à la création du SCALP (groupe d’action antifasciste). Dans les années 1980, ces militants ont réalisé 280 attentats sans faire une seule victime, ce qui témoigne d’une grande conscience éthique. Rien à voir avec le terrorisme. Ce sont des citoyens radicaux qui ne se laissent pas faire.
Propos recueillis par Eva Ségal, juillet 2015