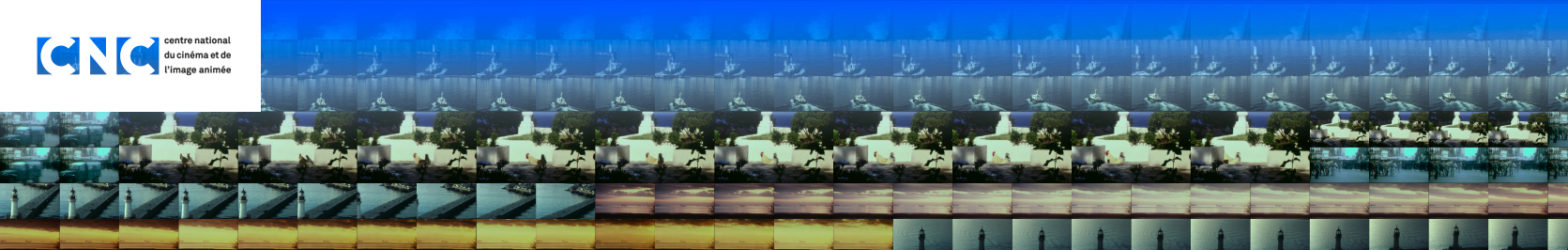Rouleaux peints

“L’Histoire est en face de moi comme un journal intime.”
C’est sur cette phrase de Wang Bing que s’ouvre le film d’Alain Mazars, La Chine et le Réel. Judicieusement, le documentaire choisit de remonter le temps de nos jours jusqu’à 1989. Car les cinéastes de la 6e génération ont beau être diplômés de la prestigieuse Académie de cinéma de Pékin, ils naissent au cinéma avec les massacres de la place Tian’anmen au printemps de cette année-là. Alors que des étudiants, intellectuels et ouvriers dénoncent la corruption et demandent des réformes démocratiques, le gouvernement envoie l’armée et transforme la manifestation en bain de sang. Contrairement au cinéma de la 5e génération 1, ce nouveau cinéma naît de la nécessité de montrer le présent sans voile. Il est fini le temps de se pencher sur le passé, le temps des allégories pour déjouer la censure, et du 35 mm soigné. Si Epouses et Concubines de Zhang Yimou (1991) ou Adieu ma concubine de Chen Kaige (1993) sont l’apogée de la reconnaissance internationale du cinéma chinois, Wang Bing, Jia Zhangke, Wang Xiaoshuai ou encore Zhang Yuan, longuement interviewés dans La Chine et le Réel, dressent au même moment un portrait du pays en un tout autre style : le réalisme – loin d’être une exception dans le cinéma chinois puisque le réalisme socialiste, fortement inspiré par le cinéma d’URSS, a déjà dominé après la proclamation de la République Populaire en 1949.
Le cinéma chinois a en réalité toujours oscillé entre ces deux pôles, un réalisme toujours plus tranchant et un imaginaire toujours plus merveilleux, dont le cinéma hongkongais de studio est le zénith, allant jusqu’à créer un genre de cape et d’épée inscrit dans la culture nationale, le wu xia pian. Hubert Niogret consacre un documentaire au maître incontesté du genre, King Hu (Pékin, 1931 ; Taipei, 1997 – année de la rétrocession de Hong-Kong à la Chine). Derrière l’apparence de divertissement de ce cinéma de genre, ses films tournent autour du territoire de la Chine Populaire sans jamais y entrer vraiment. L’Histoire semble derrière King Hu comme un livre noir.
le wu xia pian entre passé et présent
Acteur célèbre à Hong-Kong, Chin Chang Hu réalise des films en s’américanisant sous le nom de King Hu et connaît son premier succès avec L’Hirondelle d’or (1966). Hubert Niogret interroge ceux qui l’ont connu, acteurs, producteurs, assistants, et offre une image de l’homme bien loin du clown qu’il savait être à l’écran. Homme cultivé, il donne au cinéma ses lettres de noblesse, le considérant comme un art et non comme un pur divertissement, contrairement à ses contemporains. La productrice et critique Peggy Chao insiste sur son sens plastique. L’apparition et la disparition des personnages dans la nature, les visages peints qui définissent le personnage en lui donnant un âge, une appartenance sociale, un caractère, ou encore les combats chorégraphiés comme des danses sont autant de survivances de l’opéra traditionnel de Pékin. La violence y devient même une forme d’abstraction, pour preuve la très faible représentation du sang dans ses films.
L’autre aspect de la personnalité de King Hu bien mis en valeur dans le documentaire est sa capacité de travail titanesque. Son perfectionnisme ne va pas sans une certaine lenteur – ce qui déplaît à la Shaw Brothers qu’il quitte pour réaliser des films à Taiwan dès 1967. S’il se prête à tous les rôles, de la calligraphie pour le générique au dessin de chaque plan, de la construction des décors au jeu devant ses acteurs, chacun de ses projets de film commence par une importante recherche historique. Pour Dragon Inn (1967) et Touch of Zen (1969), il s’est précisément documenté sur le pouvoir des eunuques sous la dynastie Ming. Dans le premier film, l’auberge du Dragon réunit les exilés à la frontière, tandis que dans Touch of Zen, après l’assassinat de son père, la jeune Yang lutte contre les hommes du grand Eunuque avec deux hommes rencontrés dans sa fuite, un moine bouddhiste et un intellectuel aux méthodes de combat poussées. Il s’agit alors de créer un contre-pouvoir.
Inventif et poétique, son cinéma est une remarquable passerelle dans le temps. Tigre et Dragon d’Ang Lee (2000) et Le Secret des poignards volants de Zhang Yimou (2003) lui rendent hommage, remettant au goût du jour le wu xia pian, tandis que Tsai Ming-Liang dans Goodbye Dragon Inn (2003) montre une salle de cinéma qui ferme, passant une dernière fois un film de King Hu. Son personnage erre dans le cinéma et y croise les acteurs à présent âgés de Dragon Inn venus voir le film trente-sept ans après sa sortie. Goodbye Dragon Inn, comme le titre l’indique, est un véritable éloge funèbre : le cinéma aimé n’est plus.
un nouveau réalisme
Les cinéastes de la 6e génération utilisent les nouveaux moyens de tournage, la vidéo, des caméras plus petites, pour fabriquer des films volés, du cinéma direct, en phase avec le présent. Tourné au sortir de l’école dans un état d’innocence, Mama de Zhang Yuan (1992) est considéré comme le premier film indépendant chinois. A mi-chemin entre la fiction et le documentaire, il ouvre la voie d’un nouveau réalisme. Il est peu étonnant dès lors que ces cinéastes passent d’un genre à l’autre avec une grande facilité. Le documentaire In Public (2001) de Jia Zhang-ke annonce sur bien des points sa fiction Plaisirs inconnus (2002), tandis que l’interview fleuve de Fengming, chronique d’une femme chinoise (2007) et la fiction Le Fossé (2010) de Wang Bing sortent en même temps en France, comme liés par leur sujet – les camps de rééducation pendant la Révolution culturelle.
Dans les deux films de Wang Bing, une femme est au cœur d’une recherche historique : Fengming, témoigne des épisodes tragiques de son passé, alors que la femme du Fossé cherche le cadavre de son mari dans un désert-charnier. In Public et Fengming, s’ils sont des terrains d’expérimentation, ne sont en aucun cas des brouillons de fictions à venir ; ce sont des propositions esthétiques radicales – en premier lieu l’utilisation du temps réel : l’attente d’une femme qui doit prendre un bus, ou la parole de Fengming, sans coupe.
Moins radical mais tout autant inscrit dans le réel, Wang Xiaoshuai puise son inspiration dans les faits divers. Il réalise Frozen (1996) à partir de l’histoire vraie d’un artiste qui fait de sa mort sa dernière performance. Une Famille chinoise (2007) s’inscrit dans l’évolution des meurs et de la médecine, en se nourrissant d’une intrigue tirée d’un article de presse : une femme demande à son ex-mari de lui faire un enfant pour sauver leur petite fille qui a besoin d’une greffe. Chongqing Blues (2010) s’inspire du blog d’un policier où il a raconté une prise d’otages dans un supermarché. Tous ces films dressent des portraits au présent. Le cinéaste ajoute d’ailleurs qu’il ne referait pas les films à l’identique aujourd’hui : le vélo, encore emblème en 2000 de la société chinoise dans Beijing Bicycle, serait remplacé en 2012 par les nouveaux modes de communication virtuels.
Symptôme de cette recherche de modernité : le nouveau cinéma fuit la campagne pour s’intéresser au monde urbain, à la jeunesse, au monde du travail, et en particulier du travail illégal. Xiao Wu artisan pickpocket (1997), premier film de Jia Zhang-ke et titre hommage à Bresson, est une métaphore de l’évolution économique du pays. Le personnage est en quelque sorte le dernier artisan face à l’apparition de nouveaux métiers déshumanisés : il porte la marque d’un monde en voie de disparition. Il faut voir Xiao Wu retrouver un ancien ami voleur qui ne veut pas l’inviter à son mariage avec la fille d’un riche entrepreneur. Cet ami se marie pour l’argent, comme un pacte signant son entrée dans la légalité – légalité nettement vue comme une trahison et une forme de prostitution. La jeune femme travaillant dans un karaoké dont Xiao Wu tombe amoureux, trop pauvre, est quant à elle obligée de disparaître à la campagne. Peut-on encore aimer dans ce nouveau monde ? Le final du film, sans ambiguïté, laisse le personnage attaché à un poteau par la police en pleine rue, offert aux yeux de tous, tel le Christ sacrifié d’une génération perdue. Dès son film suivant, Platform (2000), qui s’étire de 1979 à 1990, Jia Zhang-ke fait de ses personnages perdus dans leur époque les témoins d’une mémoire collective qui s’effrite.
paysages
Le style de Jia Zhang-ke est remarquable aussi par sa saisie de l’espace. A l’arrière plan de Xiao Wu artisan pickpocket, c’est toute une ville qui est en train de s’effacer : les affiches décollées, déchirées, devenues illisibles, sont autant de signes d’une mort annoncée. Dans Still Life (2006), il entrelace des histoires simples dans un site naturel grandiose, bouleversé à jamais par l’homme : dans une ville qui sera submergée par le barrage des Trois-Gorges quelques mois plus tard, en parallèle, un mineur cherche sa femme qu’il n’a pas vue depuis des années et une femme cherche son mari pour en divorcer. L’histoire intime est un prétexte pour saisir un espace collectif sur le point de disparaître. Jia Zhangke donne à voir la disparition tragique de ce paysage jusque-là considéré comme éternel, à l’origine de tout un art pictural, comme l’effacement même de l’art, du temps et de la mémoire.
Son projet se précise encore avec le diptyque 24 City (2008) et I wish I knew (2010) : le premier montre des témoignages filmés dans une cité ouvrière en train d’être détruite au profit d’un complexe immobilier de luxe ; le second propose, sur le même principe, un portrait de Shanghai des années 1930 à nos jours. Les interviews alternent fiction et documentaire sans distinction apparente. Cette attention au lieu en tant que révélateur d’une Histoire qui le dépasse est générale dans le cinéma chinois.
Le gigantesque complexe industriel de Shenyang – son agonie, et le corps de l’homme assujetti à cette agonie – est le sujet du documentaire majeur de Wang Bing, A l’Ouest des rails (2003). Le film est partagé en trois chapitres : Rouille entre dans les usines, Vestiges s’aventure dans les ruelles de la cité ouvrière, et Rails suit le chemin de fer en voie d’abandon. En suivant ce trajet, le cinéaste filme des moments de vie – la douche des ouvriers, la remise des salaires – comme autant de sommets visibles d’un iceberg qui s’effondre. Le paysage industriel est donc le récit même, fondement d’une narration qui a quelque chose du rouleau peint, à la fois par sa durée (9 heures) et son fonctionnement par saynètes saisies en chemin.
C’est là peut-être que le cinéma contemporain chinois rejoint la tradition d’un King Hu. Comme le fait remarquer Peggy Chao, ses longs panoramiques accompagnent les personnages dans les forêts, déroulant également le paysage comme un rouleau peint. La grande attention de King Hu aux décors n’est pas anodine : un lieu perdu, détruit ; une forêt ou une ruine pour s’abriter ; une auberge d’exilés. Dans ces espaces hostiles ou refuges, les personnages n’ont de cesse de changer les lois de la gravité, s’envolant pour se battre, défiant par leur vitesse la vision, invitant le spectateur à découvrir la pérennité nouvelle de ces paysages. Comme dans Still Life, ceux-ci s’inscrivent dans la tradition d’une Chine ancestrale, d’un art qui, au temps de King Hu n’est plus autorisé – la peinture se doit d’être réaliste, compréhensible par tous. En s’inspirant de tableaux de montagne et d’eau, depuis Hong-Kong et Taiwan, King Hu place son cinéma sous le signe d’une esthétique interdite par la République Populaire. C’est comme si, à travers l’action du wu xia pian, il voulait garder une trace, une mémoire vive de ces paysages. Ce geste le rend étrangement contemporain d’un Wang Bing ou d’un Jia Zhangke, qui cherchent à rendre visibles dans le trop-plein du présent assassin les ruines d’une histoire en marche.
Martin Drouot, décembre 2012.
1 L’acte de naissance de la 5e génération est la projection au festival de Hong-Kong en 1985 de Terre jaune de Chen Kaige. Ce succès retentissant est suivi par La Loi du terrain de chasse de Tian Zhuang-zhuang (1985) et Le Sorgho rouge de Zhang Yimou (1987). Ces films sont ancrés dans le monde rural, et participent d’un retour aux racines chinoises, notamment en magnifiant une tradition picturale et musicale orientale.