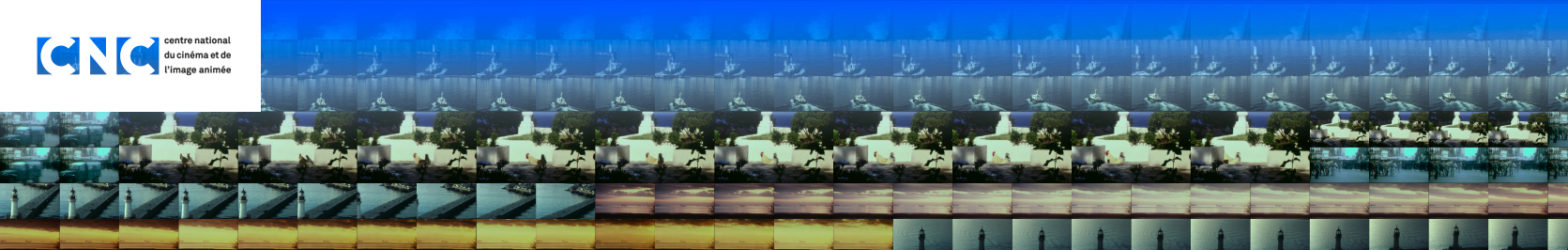Stigmates de la guerre du Vietnam

Madame Bua est une femme sans âge, à la silhouette marquée par l’Histoire, celle de la guerre du Vietnam. En l’observant au fil des jours, la réalisatrice vietnamienne Thu Duong Mong aborde non pas tant le souvenir du conflit que la manière dont il continue de survivre et d’impacter le quotidien plus d’un demi-siècle plus tard. Ainsi, ce moment du film où Madame Bua et ses voisins dînent ensemble, en pleine rue.
Sans doute après quelques verres, les langues se délient-elles et l’un d’eux lui demande avec insistance de raconter ses “méthodes” lorsqu’elle appartenait au Viet Cong. Après quelques circonvolutions oratoires, Madame Bua explique qu’elle séduisait les soldats ennemis et que ce n’était pas par la propagande qu’elle les amenait à rejoindre le Viet Cong. “Je me suis donnée à lui, sacrifiant mon corps pour le peuple et la patrie.” Etrangement dans ce récit, le pluriel se confond avec le singulier et le présent fusionne avec le passé dans une cacophonie temporelle qui rend soudain les temps anciens très actuels. Madame Bua admet qu’elle enchaînait “les missions”, mais elle ne laisse entendre qu’un seul amant.
Dans cette atmosphère étrange où les souvenirs ressurgissent sous une forme anecdotique, les corps démentent la superficialité des événements narrés : Madame Bua continue de subir dans sa chair l’onde de choc des tortures endurées lors de ses emprisonnements, et l’un de ses interlocuteurs à la table a perdu une jambe en combattant pour le camp adverse. Tous deux rient en racontant leurs histoires devant leurs voisins, mais lorsqu’ils se serrent la main, la rencontre de leurs souffrances ennemies symbolise soudain avec intensité la fragilité des destins. “Mais les temps ont changé et à présent nous nous serrons la main”, souligne le voisin insistant. “C’était à cause de la guerre” répond alors l’unijambiste sur fond de petits rires nerveux de toute la tablée. “A présent, nous passons toute notre vie à parler de ce temps-là”, conclut-il avant de s’éloigner en claudiquant.
“Parler de ce temps-là” n’est justement pas l’objectif de La Natte de Madame Bua, qui s’ancre résolument dans son époque pour livrer un portrait fragmenté, un témoignage éclaté, dans lequel s’enchâssent les récits secondaires du quartier. Fidèle à l’éthique vériste des Ateliers Varan, ce film n’est pas tant un regard qu’un médiateur. La caméra évolue dans le sillage de Madame Bua sans jamais imposer sa présence, laissant le spectateur libre d’écouter, de voir, de comprendre la réalité à laquelle il assiste, sans jamais forcer son jugement par des prises de parti esthétique ou narratif. Pourtant, si Madame Bua n’est pas un personnage de fiction, elle reste une héroïne dont la banalité de la vie quotidienne contraste avec la violence des souvenirs.
la natte
Le titre donné par Thu Duong Mong à son film fait tout d’abord référence à l’épilepsie dont souffre Madame Bua. Cette natte, sur laquelle elle s’allonge lors de ses crises, est donc synonyme de ses maux, de ses douleurs issues d’un autre temps, de la torture
dont elle a été victime et des séquelles qui marquent encore son corps. L’un des voisins explique d’ailleurs que lors de ses crises d’épilepsie, elle les inquiète, les apeure et leur échappe ; plongée soudain au cœur de l’horreur, dans le cauchemar de ses souvenirs, elle parle anglais et hurle à ses bourreaux de l’épargner.
Mais cette natte, dans une lecture polysémique, pourrait évoquer également les cheveux de Madame Bua qui font partie des stigmates de son calvaire. Ses geôliers ont vu dans son opulente chevelure un moyen de se soustraire à eux, de se suicider. Ils les lui ont donc arrachés et son crâne clairsemé porte à jamais la marque de son sort et de l’abandon dont elle fut victime dans la foulée, quand la famille de son mari la découvrit ainsi défigurée.
Lors d’un moment privilégié avec sa fille, alors que celle-ci coiffe patiemment et délicatement les mèches éparses de sa mère, Madame Bua raconte les mutilations dont elle fut victime, le sadisme de ses tortionnaires (quatre Américains et deux traducteurs) qui la forcèrent à manger du pain imprégné de son sang. Elle tourne le dos à sa fille, et le seuil de la maison sur lequel elles sont assises lui offre l’abri d’un contre-jour. La caméra de Thu Duong Mong tourne autour d’elle, captant cette scène intime avec pudeur, tout comme elle l’avait fait quelques séquences plus tôt lors d’un monologue introspectif au cours duquel la vieille dame, les yeux baissés, occupée à laver son linge à la main, livrait ses souvenirs : son mariage, sa libération et l’enfant naturel qu’elle eut, croyant se guérir par cette naissance de son épilepsie. La réalisatrice choisit systématiquement dans ces moments de confidences des cadres latéraux, comme pour traduire l’attitude de Madame Bua qui ne se livre que par détours : l’humour, la chanson ou la confession sans interlocuteur direct.
La réalisatrice complète ce dispositif par une délinéarisation du tournage. Les souvenirs de Madame Bua, déjà divisés en plusieurs temps et plusieurs lieux (soirée avec les voisins, monologue du linge, dialogue avec sa fille) sont ensuite morcelés au montage dans un désordre chronologique. Le portrait de la vieille dame devient ainsi un jeu de piste dans lequel le passé envahit un présent qui toujours le submerge.
La Natte de Madame Bua n’offre pas une réflexion sur la guerre, mais sur l’impossible paix des âmes après l’horreur des combats, de la captivité et de la torture. Ce n’est jamais la Madame Bua d’alors qui revit sous nos yeux, mais la Madame Bua de maintenant qui survit cernée par les démons du passé ancrés dans son corps à jamais. La séquence finale du film est d’ailleurs particulièrement bouleversante : la vielle femme, étendue les yeux clos près de sa petite-fille encore bébé, la berce d’une mélopée effrayante, lui racontant les sévices et la haine de l’envahisseur occidental, comme si tout moment d’apaisement devait fatalement rimer avec l’exorcisme de sa souffrance qu’elle fredonne à défaut de pouvoir encore la hurler.
Delphine Robic-Diaz (février 2015)