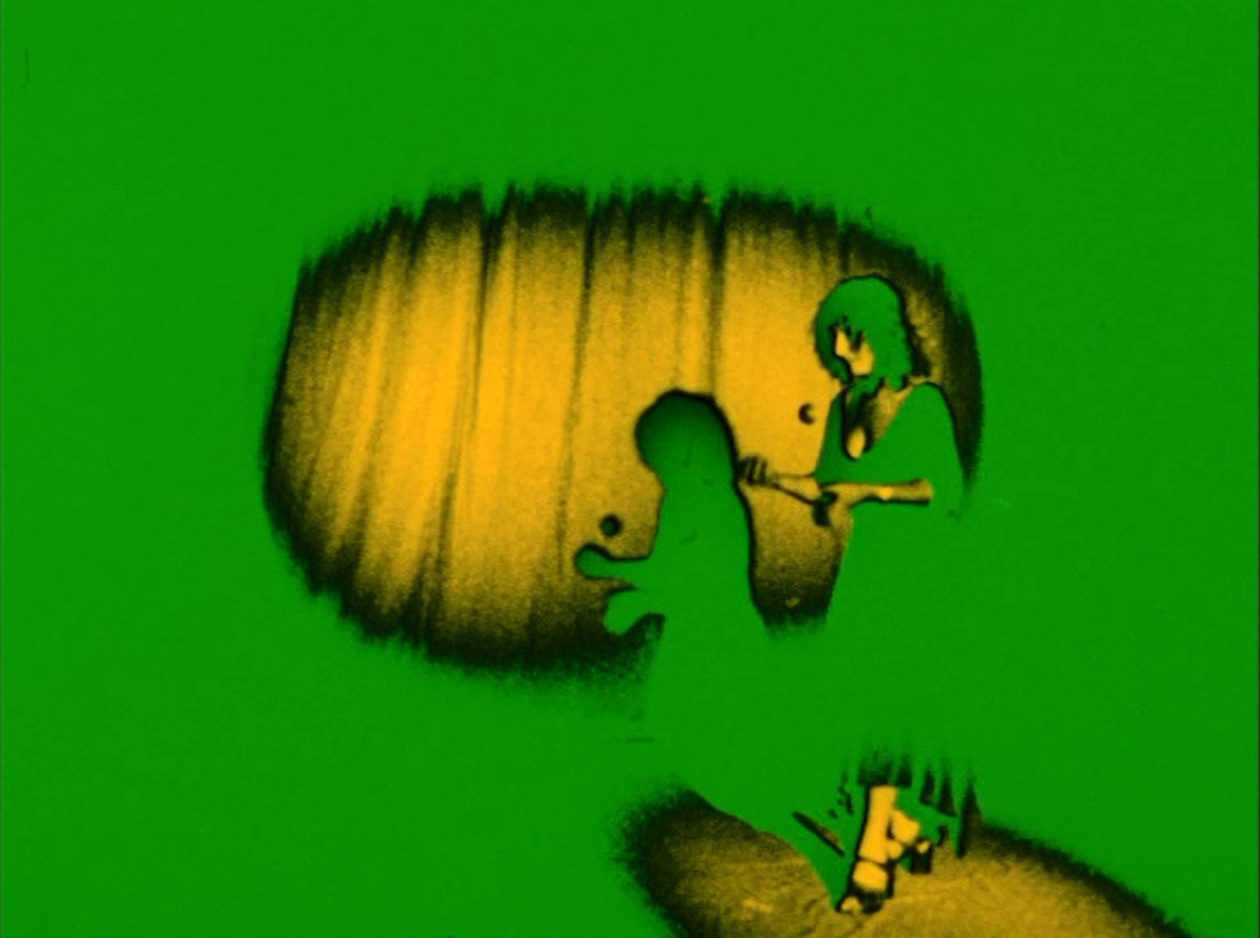Tartalom megjelenítő
Les énigmes du Sphinx

En 1975, Laura Mulvey écrit Plaisir visuel et cinéma narratif (Visual Pleasure and Narrative Cinema, Screen n°16), article dans lequel elle élabore une critique radicale de la place faite aux femmes dans le cinéma hollywoodien. S’appuyant sur les concepts de la psychanalyse, elle s’attache à déconstruire la “magie” du cinéma, expression selon elle de l’ordre patriarcal qui règne dans la société. Cette déconstruction repose sur l’hypothèse que le plaisir éprouvé par le spectateur de cinéma n’est que la prolongation d’un plaisir de voir plus fondamental, qui joue un rôle particulier dans la formation psychique des individus. Ce plaisir de voir, Laura Mulvey l’envisage sous deux aspects : d’une part la scopophilie (ou voyeurisme), étudiée par Freud, d’autre part le processus d’identification, à l’œuvre dans le stade du miroir étudié par Lacan.
D’après Freud, la scopophilie est un instinct sexuel qui consiste à prendre l’autre comme objet de plaisir en le soumettant à la curiosité de son regard. En le plongeant dans le noir, en l’isolant de la scène qui se déroule sur l’écran, le cinéma jouerait des fantasmes voyeuristes du spectateur. Dans le stade du miroir, l’enfant face à sa propre image développerait un idéal du moi, il verrait dans son reflet un corps plus habile que son corps propre. Ce mécanisme d’idéalisation serait réactivé au cinéma par l’identification avec les personnages.
Mais au sein d’une société dominée par les hommes, ce plaisir est distribué de manière inégale. Sur l’écran, la femme apparaît comme une image, elle est l’objet de la pulsion scopique du spectateur, tandis que l’homme est le détenteur du regard et le maître de l’action. Le personnage masculin à l’écran représente l’idéal du moi dans toute sa puissance auquel le spectateur est amené à s’identifier. L’image de la femme est façonnée en fonction du plaisir de l’homme, réglée sur ses fantasmes.
Pour rendre ce plaisir possible, pour permettre au spectateur de l’éprouver, le film doit respecter certaines conditions formelles. Le cinéma repose sur la combinaison de trois regards différents : le regard de la caméra, celui du spectateur et celui des personnages au sein du récit. L’illusion cinématographique, condition du plaisir de voir, repose sur la disparition des deux premiers regards au profit du troisième. Le spectateur ne doit pas être conscient du dispositif d’enregistrement, il ne doit pas être conscient qu’il regarde, il doit pouvoir se projeter entièrement dans le film.
Ce plaisir étant accordé à une perception masculine, il importe pour faire évoluer la société d’en faire apparaître les rouages. Dès lors, ce que propose Laura Mulvey c’est une destruction du plaisir, tâche qu’elle assigne au cinéma d’avant-garde et qu’elle mettra en pratique dans son film Riddles of the Sphinx, coréalisé avec Peter Wollen deux ans plus tard.
détruire le plaisir
Riddles of the Sphinx s’appuie sur les mêmes prémices psychanalytiques que l’article Visual Pleasure and Narrative Cinema. Dans un préambule, la réalisatrice elle-même, assise devant un fond noir et derrière un bureau encombré de livres et d’objets, expose le parti pris du film et son soubassement théorique. Dans le mythe d’Œdipe, érigé par Freud au rang de mythe structurant de la société, le Sphinx (qui est féminin) occupe une place périphérique. Cette figure monstrueuse rejetée en dehors des murs de Thèbes renvoie à l’angoisse de la castration, liée à l’absence de pénis chez la femme, et offre une image inversée de la place des femmes au sein de la cité : soumises à l’ordre symbolique, c’est-à-dire au langage des hommes, réduites à la fonction de mères.
Selon Laura Mulvey, la figure du Sphinx, redécouverte avec la conquête de l’Égypte par Napoléon, est associée dans l’esprit moderne à la femme fatale et à toutes ses déclinaisons vampiriques. Le Sphinx (ou la Sphinge) est le symbole d’une double disparition des femmes : comme objet de fantasme et comme figure maternelle. À travers l’histoire d’une jeune femme confrontée à la maternité, racontée en treize séquences, il s’agira dans le film de faire entendre la voie du Sphinx. Non pas la voix de la vérité, celle qui a cours dans l’ordre symbolique, mais la voix de l’énigme, celle d’un être en quête d’identité, s’ignorant lui-même parce que soumis à un système qui lui assigne une fonction prédéfinie.
Mais cette histoire, suivant le programme établi par l’article de 1975, ne peut pas adhérer aux règles de l’illusion cinématographique. Il doit y entrer une certaine distance qui lui permette d’échapper au “plaisir de voir”. Le préambule est en lui-même un premier pas dans ce sens : non seulement il met en scène la réalisatrice, mais il annonce le découpage des séquences du film à la manière du sommaire d’un livre par un jeu de titres en surimpression. Par là, le film se réclame d’emblée de l’essai ou d’une démonstration scientifique plus que d’un récit classique fondé sur la vraisemblance et l’identification.
Dans l’article de 1975, Laura Mulvey définissait deux régimes visuels qui entrent en tension au sein du cinéma hollywoodien : d’une part la femme passive réduite à une image à deux dimensions, d’autre part l’homme actif se déplaçant dans un espace vraisemblable à trois dimensions. Cette vraisemblance était la condition de l’identification au corps de l’homme exerçant sa puissance et le ressort de l’illusion cinématographique. Briser cette illusion consistera à intégrer à l’expérience du spectateur les deux éléments qui en étaient effacés : la présence du dispositif d’enregistrement et la conscience du public se sachant regarder.
Pour cela, Laura Mulvey découpe son récit en treize panoramiques constituant chacun une séquence. Elle rompt donc avec le montage qui vise à garantir la vraisemblance par la fluidité des coupes pour donner à la caméra le rôle d’un instrument d’observation d’une objectivité toute mécanique. Imperturbablement, celle-ci décrit une série d’espaces où se déroule l’action en tournant régulièrement sur elle-même à 360 degrés. Détaillés de la sorte, ces espaces apparaissent dans toute leur étrangeté, un peu comme si une sonde spatiale ou un robot avait filmé la surface d’une autre planète. On trouve d’ailleurs dans ce dispositif un écho du célèbre Région centrale de Michael Snow (1971), où une caméra fixé à un bras articulé filme de manière autonome un paysage, voire une lointaine réminiscence de 2001, l’Odyssée de l’espace (1969) et du regard distancié de Kubrick sur une humanité prise dans l’orbite de la technique. Une atmosphère de science-fiction que renforce la bande originale composée au synthétiseur par Mike Ratledge, claviériste du groupe Soft Machine. Mais les espaces filmés n’ont rien d’extravagant. Ce sont les lieux du quotidien : intérieur d’une maison, lacis de passerelles et de routes, aire de jeu d’un jardin public, centre commercial, qu’il nous faut considérer au prisme de l’expérience d’une jeune femme qui ne veut pas se séparer de son enfant.
texture du sens
En adoptant ce dispositif formel, Laura Mulvey s’aventure dans une zone incertaine à la frontière du film expérimental et de l’enquête sociale. Toutefois si la caméra fait sentir sa présence (jusqu’à apparaître dans le reflet d’un miroir) et si le spectateur est maintenu à une distance qui le rappelle à l’acte de voir, c’est bien un récit que nous propose le film. Si Laura Mulvey invitait le cinéma d’avant-garde à détruire le plaisir élaboré au sein du cinéma hollywoodien, à répondre à la fascination par la distanciation, elle appelait également à l’invention de nouvelles formes de plaisir qui pourraient émerger de formes nouvelles de représentation. Il ne s’agit pas d’un renoncement sans appel au plaisir, mais d’une invitation à transformer le regard pour faire émerger un autre imaginaire et une autre réalité.
Or c’est exactement le cheminement que suit le personnage. Mère d’une petite fille, Louise ne veut plus sortir de chez elle de peur d’avoir à se séparer de son enfant. Enfermée dans la maison qu’elle partage avec son compagnon, elle enchaîne les tâches ménagères en ressassant des pensées morcelées qui reflètent ses inquiétudes, sa souffrance et sa soumission à l’ordre familial.
En réaction au comportement de Louise, son mari décide de quitter la maison. Elle est alors contrainte de trouver un travail et de confier sa fille à d’autres femmes dans une crèche. Employée dans un standard téléphonique où travaillent exclusivement des femmes, elle fait la connaissance de Maxine et participe à des discussions sur leurs conditions de travail, principalement sur les contradictions entre le rôle de mère et la valorisation du travail des femmes. Elle franchit alors un premier pas dans la compréhension de sa situation. Chaque espace qu’elle traverse apparaît non plus comme l’espace banal de la vie quotidienne mais comme un cadre structurant, expression d’un ordre social arbitraire fondé sur l’inégalité entre les hommes et les femmes. La réticence éprouvée par Louise à sortir de la maison peut alors se comprendre comme une angoisse face à la double injonction d’adhérer à la fonction de mère et de se séparer de son enfant pour qu’il puisse intégrer l’ordre symbolique, dont il reproduira les valeurs et le fonctionnement.
Mais quelque chose arrive dans les deux dernières séquences du récit qui dépasse cette prise de conscience : dans la relation qui se noue avec Maxine, Louise entrevoit la possibilité d’un autre langage, d’un autre horizon que celui de l’ordre symbolique du patriarcat. Enfermées dans une chambre, les deux amies lisent les rêves que Maxine a notés dans un carnet. Cette espace se distingue clairement de tous les autres : il est rempli d’objets et de miroirs, les murs sont couverts de tentures. Les rêves énigmatiques parlent de révolte contre les hommes et leur trame onirique a la texture du sens. Dans une dernière séquence, Louise se déplace dans la salle d’égyptologie du British Museum. Elle se souvient d’un rêve qu’elle a fait où figuraient des acrobates. Si les hiéroglyphes évoquent la possibilité d’un autre langage, les acrobates symbolisent la liberté du corps qui défie la pesanteur et trouve sa liberté dans ses propres forces.
Presque contemporain de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman, qui date de 1975, Riddles of the Sphinx s’engage dans une autre voie pour parler de la situation des femmes. Chez Chantal Akerman, c’est le réalisme cinématographique qui est poussé dans ses retranchements : montrer au cinéma les gestes domestiques qui en sont absents, les souligner par la durée, raconter une souffrance qui conduit jusqu’au drame. Laura Mulvey, elle, ouvre une perspective plus utopiste. Elle rejoint en cela les récentes tendances du féminisme qui trouvent leur expression dans un documentaire comme Story Telling for Earthly Survival, où la théoricienne américaine Donna Haraway parle de l’importance d’imaginer de nouveaux récits et de tisser de nouvelles relations pour transformer l’ordre du monde.
Sylvain Maestraggi, juin 2019.