アセットパブリッシャー
Au-dessus des gravats et des ruines
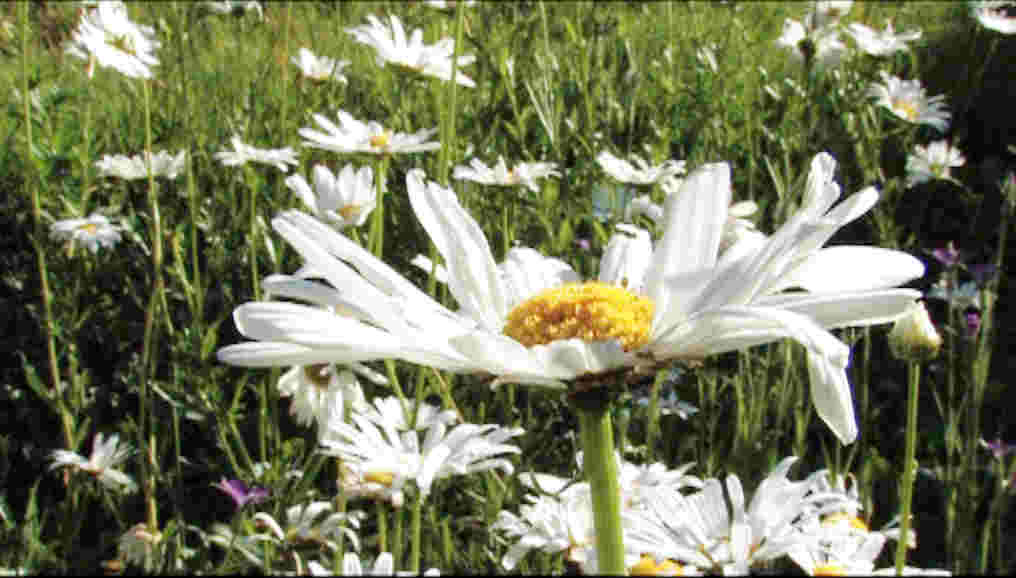
Enclave de nature cultivée dans un quartier populaire de Paris, à la population métissée et au bâti très dense, le parc de Belleville forme une sorte de cœur qui s’étend à flanc de colline, sur 45 hectares, entre la rue Piat et la rue du Transvaal au nord-est, la rue des Couronnes au sud et la rue Julien Lacroix à l’ouest. Rue Piat, la terrasse qui longe le haut du jardin offre sur la ville un panorama magnifique.
Il y a beaucoup à voir dans ce jardin, par exemple, en aplomb, la lune, pleine et plutôt froide. Ou bien, en écho, formant une ligne sinueuse, les globes lumineux d’une série de lampadaires. Les pentes, certains parapets et des grilles, les bordures d’allées et les allées elles-mêmes dessinent d’autres courbes, d’autres réseaux de lignes sinueuses que viennent interrompre les lignes droites et perpendiculaires d’escaliers plus ou moins abrupts. Même jeu de contrastes entre des courbes, des verticales et des horizontales pour la Maison de l’air bâtie en contrebas du belvédère.
Il y a aussi beaucoup de sons dans ce jardin : on entend notamment le vent dans les arbres, le ruissellement de l’eau de la fontaine en cascade, le crépitement de la pluie, le crissement des pas sur un sol enneigé, le pépiement d’un oiseau – une mésange peut-être, à moins qu’il ne s’agisse d’une fauvette à tête noire – auquel répond un autre oiseau, le croassement de quelques corbeaux qui tournoient à la cime d’un arbre (“il paraît qu’ils portent malheur”), un geai, identifié, et puis le battement d’ailes d’un envol de pigeons. Dans le lointain, on entend le tintement des cloches de Notre-Dame de la Croix et, tout près de nous, faisant éclater la “couronne de silence” qui entoure et annonce “tout vrai jardin”, en fait “un espace de liberté”, les pétarades d’invisibles deux-roues à moteur.
Mais, pour revenir au jardin, on y voit des chats – celui-là s’étire paresseusement tout en faisant ses griffes sur le tronc d’un arbre, mais sa langueur n’est peut-être qu’apparente, les oiseaux ne sont pas loin. Des chiens aussi, mais assez peu, des insectes en liberté… et un jour de pluie, sur une musique de pluie, un escargot qui traverse une allée. On voit, forcément, des végétaux en grand nombre, des végétaux de toutes sortes et dans tous leurs états, des herbes et des feuilles, des buissons, des arbustes et des arbres : chênes, hêtres et tilleuls, marronniers et noyers, arbres de Judée, frênes d’Amérique, orangers du Mexique, pommiers, catalpas, cyprès chauves et ginkgos – si toutes ces essences, parmi celles qu’énumérait Robert Bober en 1992 dans En remontant la rue Vilin, n’ont pas été depuis remplacées par d’autres... Il y a également des choisyas qui sentent l’eucalyptus et même quelques pieds de vigne dont on fait du vin, peut-être en souvenir de la “piquette” de Belleville. Et puis il y a des fleurs, bien sûr, que seul Gérard peut nommer toutes, y compris de leur nom latin.
Gérard, c’est Gérard Joubert, le jardinier. Il est le maître de céans, l’hôte de cette “oasis” – c’est ainsi qu’il l’appelle –, il en est l’âme, le veilleur bienveillant. Il dirige et conseille l’équipe des jardiniers, saisonniers et apprentis : Aurélien, Blaise, Camille, Hervé, Jonathan, Sébastien, Thomas, William et Yves, qui à longueur d’année balayent, ratissent, taillent, tondent, plantent, arrosent… Il accueille, renseigne et guide parfois les visiteurs, il ne manque jamais de saluer ses connaissances – forcément, depuis le temps, il en a beaucoup. Et, inlassablement, il arpente son territoire, attentif au moindre mouvement, à la moindre variation.
La nuit, le jardin est le domaine exclusif d’une faune animale plus ou moins répertoriée. Mais le jour, il ouvre ses portes aux promeneurs. On entend alors des voix, des musiques et des rires. Selon les heures du jour et le temps qu’il fait, le jardin est calme ou très animé. Mais, de manière générale, sans compter les jardiniers, il y a beaucoup de gens dans ce jardin – passants, visiteurs occasionnels, habitués – et beaucoup d’activité. Par exemple, une joggeuse, une jeune fille qui lit, assise à califourchon sur un banc, un “nourrisseur de chats” et des dames qui donnent à manger aux pigeons, des pratiquants de tai-chi ou de gymnastique chinoise, des danseurs de tango de tous âges, des basketteurs, des joueurs de ping-pong, des mères qui promènent leurs enfants parmi lesquels Aïna et sa maman Sophie, une troupe de théâtre mêlant des adultes et des enfants masqués ou grimés, une femme qui dessine au fusain le détail d’une branche d’arbre… Il y a des gens solitaires, à deux, en famille ou en groupe, des gens à l’arrêt, debout, assis, allongés sur les pelouses, des gens qui marchent, fument, bavardent, contemplent le jardin, dorment ou se font bronzer. Des enfants qui courent ou barbotent dans l’un des bassins de la fontaine en cascade, des enfants qui jouent, sur l’une ou l’autre des aires de jeu, se livrent des batailles de boules de neige ou apprennent à planter des impatientes. Il y a aussi des musiciens : Patrick Scheyder interprète le prélude no 8 du Clavecin bien tempéré de Bach sur un piano à queue planté sur une pelouse ; assise sur un banc, Natalya N’Rouv joue une mélodie de sa composition à l’accordéon et, malgré la pluie battante, les trois rappeurs de Conscience Ebène rassemblent un public nombreux sur les gradins de l’auditorium.
mesures du temps qui passe
Parmi tous ces gens, certains ne font que passer devant la caméra de Frédérique Pressmann ou c’est elle qui les capte et les suit, longuement parfois. D’autres s’arrêtent et conversent avec elle : le jardinier sourd qui adore son métier, “[il est tombé] dedans quand [il était] petit”, et regrette simplement de n’avoir jamais pu entendre le bruit de la mer ; la femme africaine qui vit en France depuis six ans, qui y vit mal et aimerait tant s’intégrer ; le jeune Chinois qui, à son arrivée n’aimait pas Belleville, en redoutait la violence, puis a fini par apprécier le mélange, “les rencontres entre personnes et cultures différentes” ; la veuve au manteau rouge qui voudrait changer d’appartement ; le rappeur Noledge qui rappelle que ce quartier “est historiquement un lieu de révolte” et pense que “faire danser les gens c’est bien, les faire réfléchir c’est mieux” ; l’Espagnol nostalgique qui, de retour pour la première fois depuis quarante ans, ne retrouve rien de la cité des Envierges où il a vécu autrefois ; et puis Gérard, le jardinier philosophe qui essaie d’entrer en communication avec le bois de la vigne, qui se sent responsable de l’endroit où il vit, qui estime qu’“autour de soi, on a tout pour être bien” et qui voit dans le printemps “de la poésie accrochée aux branches”, “les premières notes qui s’élancent après le silence très intense de l’hiver”.
Cependant, à côté des “habitants” du jardin et du jardin lui-même, le film de Frédérique Pressmann a un autre protagoniste, majeur : c’est le temps. Parce qu’il a été tourné à toutes les heures du jour, au petit matin et à la nuit tombée, pendant une année entière. Parce qu’il montre patiemment le cycle des saisons et donne à entendre, autre mesure du temps qui passe, les cloches de l’église toute proche. Parce qu’il prend le temps, justement, de s’arrêter sur un bourgeon, le passage des nuages, la fonte d’une stalactite de glace, un oiseau dans un arbre, des herbes ployées par le vent, la main qu’un petit garçon tend sous la pluie, une femme qui chante un couplet, le soleil qui joue à travers les feuillages, un visage, une voix, une parole… ou un escargot qui traverse une allée.
Totalement immergé dans le jardin, au point qu’on en perde de vue l’inscription de celui-ci dans la ville, Le Monde en un jardin prend parfois du champ, de la distance, de la hauteur pour restituer cette inscription : les blocs d’immeubles qui enserrent le Parc ou, dans le lointain, la perspective sur Paris. Et les quelques “excursions” que le film s’autorise, ses rares échappées à l’extérieur de son périmètre, ont toutes à voir avec le temps puisqu’elles proposent par petites touches égrenées une sorte d’archéologie du jardin, témoignant de ce qu’il y avait avant, de ce qui repose en dessous.
Ainsi, depuis son balcon qui surplombe le parc de Belleville, face à la vue sur la capitale, Françoise Müller, qui a toujours vécu ici, raconte la rénovation du quartier à partir du milieu des années 1950, la démolition des maisons, des ateliers, des courettes et des passages, ces ruines et ces gravats qui constituaient pour les enfants un “super terrain de jeu”, mais qui pour certains adultes, qui s’étaient établis là et y avaient fait leur vie, étaient une véritable tragédie. Les photos noir et blanc de François Liénard documentent elles aussi la destruction progressive du quartier. Enfin, tirées d’un passé plus lointain, quelques images d’un film amateur en Super 8 montrent une famille, deux hommes, une femme et deux petites filles, un jour de fête sans doute, qui posent dans le haut de la rue Vilin et sur les escaliers menant à la rue Piat.
au détour de la rue Vilin
Il y a beaucoup à voir, à faire et à entendre dans ce jardin… De même, “il y a beaucoup de choses place Saint-Sulpice”, notait Georges Perec en ouverture de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien 1. Avec Le Monde en un jardin, c’est également à la “tentative d’épuisement d’un lieu parisien”, en l’occurrence le parc de Belleville dans le 20e arrondissement, que s’est livrée Frédérique Pressmann. Cependant, la démarche de l’écrivain, son approche en apparence factuelle, quantitative, expérimentale si l’on veut, fondée sur l’accumulation d’informations, l’effort de classement et la volonté de tout recenser, surtout le banal, l’ordinaire, jusqu’à rendre indiscernable toute vision d’ensemble, n’est pas celle qu’a choisie la cinéaste. Ainsi, place Saint-Sulpice, du 18 au 20 octobre 1974, et à nouveau le 19 mai 1978, au carrefour Mabillon, pour la description, orale cette fois, d’un autre lieu parisien 2, Perec s’était limité à une courte durée, quelques heures à peine, tandis que Frédérique Pressmann, en passant un an dans “son” jardin, a privilégié le long cours. À la froideur, à la pseudo-objectivité des faits et des chiffres, elle a préféré la délicatesse des impressions, la conjugaison de multiples points de vue subjectifs. De plus, même s’il mentionne parfois la fatigue et le froid, faisant ainsi entrer “dans le champ” sa propre subjectivité, Perec s’est résolument placé à l’extérieur de son objet d’observation, adoptant un ou une série de positions fixes (les trois cafés de la place Saint-Sulpice dans un cas, le camion studio de France Culture dans l’autre), quand Frédérique Pressmann s’est immergée dans le Parc, s’en est imprégnée, s’y est investie, modifiant constamment sa position, sa distance et, d’une certaine manière, interférant avec lui.
À aucun moment dans son film, Frédérique Pressmann ne fait ouvertement référence à Georges Perec. Pourtant, au-delà de ce qui apparaît clairement comme une visée commune, “décrire ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens […] et des nuages” 3, s’intéresser aux trajectoires et aux attitudes des passants dans l’espace, s’attacher aux détails, scruter les effets du temps (qu’il fait et qui passe) sur les lieux, Frédérique Pressmann a choisi pour cadre précis le territoire d’enfance de Georges Perec.
En effet, l’écrivain a passé rue Vilin les six premières années de sa vie et elle est l’un des douze lieux parisiens qu’il avait retenus en 1969 pour élaborer et entreprendre Les Lieux, un projet interrompu en 1975, qui devait à l’origine s’étendre sur douze années 4.
Longtemps après, en 1992, c’est-à-dire quatre ans après l’inauguration du parc de Belleville, le réalisateur Robert Bober, en un hommage à l’écrivain, est revenu sur ses pas, renouvelant ainsi, pour ce qui concerne cette rue particulière, l’entreprise inachevée des Lieux. Avec En remontant la rue Vilin, Bober “remonte” le temps : à l’aide de nombreuses photographies comme autant de “défis à la disparition”, il compose sur plus d’un demi-siècle, autour de la figure et de l’œuvre de Georges Perec, un portrait de la rue Vilin et fournit, par anticipation, une sorte d’amorce et de complément à l’“archéologie du lieu” qu’esquisse Frédérique Pressmann dans Le Monde en un jardin.
Myriam Blœdé (décembre 2012)
1 Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, 1975, Paris, Christian Bourgois, 1982.
2 Tentative de description des choses vues au Carrefour Mabillon, Atelier de création radiophonique, France Culture, 1ère diffusion le 25 février 1979.
3 Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, op. cit., p. 12.
4 Cf. Georges Perec, Espèces d’espaces (1973-74), Galilée, 1985, p. 77, où l’auteur expose ce projet qui, écrit-il, “n’est pas sans rappeler dans son principe les bombes du temps”.


