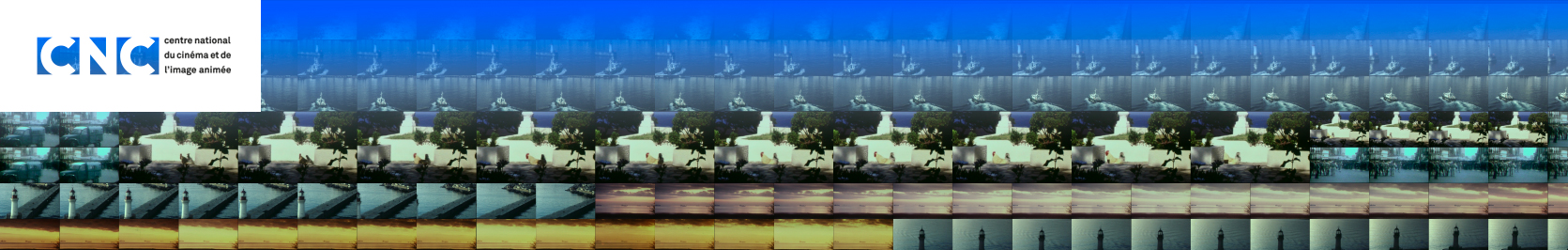Publicador de conteúdo
Conversation parisienne

Comment vous est venue l’idée de ces conversations entre artistes de la scène new-yorkaise ?
J’étais plongé depuis trois ans dans un univers de documentaires [Andy Warhol - Back to China, 2009, après deux autres documentaires produits en 2005 et 2006 sur Warhol également, Basquiat, une vie, 2010, Monsieur Hubert de Givenchy, 2011]. Je n’en pouvais plus des morts, des vieux… New York Conversations fut une manière de me raccrocher à la création contemporaine. Je rêvais de réaliser quelque chose sur le photographe Dash Snow et l’artiste Dan Colen. Mais Dash est mort en 2009 et Colen était trop mal en point. Après sa désintoxication, il a tout de même accepté l’idée d’un entretien avec le journaliste Glenn O’Brien et la machine s’est enclenchée : leur conversation fait partie du film. Par ailleurs, j’avais en tête une série de portraits de jeunes stars du cinéma américain, comme Chloë Sevigny ou Michaël Pitt. CinéCinéma, avec laquelle je travaille beaucoup, m’a plutôt suggéré un documentaire patchwork sur tous ces acteurs. Cela ne me disait rien mais m’a donné l’idée de rassembler une scène artistique dans un film et de mettre en œuvre la réflexion menée depuis longtemps sur la manière d’y insérer les conversations. Tout cela a donné New York Conversations, qui introduit la jeune génération des réalisateurs, des créateurs new-yorkais, sous forme d’entretiens.
Pourquoi avoir choisi ces images assez précaires, ces plans hachés, ces sautes brusques d’une scène à l’autre, qui distancient tant le spectateur ?
Il fallait éviter la monotonie. Le Super 8 a produit dans les années 1970 et 80 les plus belles images de New York. Comme les pellicules ne durent pas plus de 3 minutes 20, les conversations ont toutes une durée identique ; mais finalement, l’interruption de la caméra nous échappait. Et puis certaines images ont disparu au développement, à la lumière – voire au tournage lui-même. Nous avons pleinement intégré au film cette notion d’art by accident, lors du montage – on était d’ailleurs tellement emballés par ces accidents qu’il a fallu se modérer un peu ! Autre contrainte intégrée au film : le stock de pellicules de jour ou d’intérieur, de couleur ou de noir et blanc était fixe. Cela nous a imposé des choix en fonction de ce qu’il nous restait – pas toujours de ce qu’il nous fallait. Cela ajoute aux mouvements de caméra une alternance entre le noir et blanc puis la couleur.
Et que dire du mouvement perpétuel de la caméra, jamais fixe ? Cela donne un peu le mal de mer mais confère un rythme par lequel on se laisse finalement bercer.
J’avais en tête Blank Generation d’Amos Poe [1976], sur les groupes punks à New York : le bougé de caméra y est très présent, le son et l’image ne sont pas forcément synchronisés. Cela me rappelle qu’il y a trois ans, lors d’une intervention à Pékin auprès d’étudiants, j’ai été constamment interrompu par une élève qui tentait de comprendre l’intérêt de ce mouvement incessant. En vain : elle était totalement imperméable à l’idée qu’il s’agisse d’une démarche artistique ! Et puis cet effet retranscrit le sentiment d’urgence, d’agitation, propre à New York ; propre aussi à la situation dans laquelle nous étions pour ce tournage – équipe, temps et moyens réduits.
Vous venez de produire Walk away Renée de Jonathan Caouette et, en 2006, vous aviez produit et réalisé un documentaire sur Caouette lui-même (Jonathan Caouette as a Film Maker). Pourquoi cet engouement pour lui ?
Ah oui, il faut que je vous explique comment on en est arrivés là, c’est assez comique. En 2003, je travaillais avec Paul Morrissey et John Waters. Tous deux me conseillèrent de rencontrer Caouette qui venait de sortir Tarnation. Je savais à peine de qui il s’agissait et je n’avais pas retenu son nom. Au festival de Cannes en 2004, je le rencontre in extremis le dernier jour. On s’entend bien, on poursuit les échanges à distance puis Caouette disparaît de la circulation, englouti par ses problèmes familiaux. J’avais convaincu CinéCinéma de me confier la réalisation d’un projet sur lui et j’ai retrouvé sa trace. Il était d’accord, on a lancé l’affaire en moins d’une semaine pour partir tourner deux jours à New York. Avec une équipe si réduite qu’on avait oublié de chercher un réalisateur… Alors j’ai pris les commandes. On arrive chez lui, on sonne, pas de réponse. Il avait totalement oublié notre venue et il dormait ! On a finalement passé une semaine entière avec lui et on est revenu le mois suivant pour retourner avec lui à Houston, la ville où il a grandi. Je l’ai trouvé captivant, attachant. Un jour, il m’a proposé de regarder des vidéos qu’il avait tournées il y a longtemps mais pas intégrées à Tarnation. C’était la nuit, les rideaux étaient tirés, et on a regardé des images assez insoutenables de son enfance, de son adolescence.
[Sur le téléphone de Pierre-Paul Puljiz clignote un nouveau message. C’est Jonathan Caouette, justement, dont les oreilles tintaient sûrement, et qui presse le réalisateur : “Can we talk now ? I have a new thought.” Pierre-Paul sourit et reprend son récit, égrenant les grands noms qui ont jalonné son parcours et lui ont donné autant d’occasions de produire ou de réaliser des films somme toute assez variés, que ce soit sur le stade Maracana de Rio de Janeiro (2009) ou sur le chef Daniel Boulud (2008)].
Comment expliquez-vous cet éclectisme ?
Pour Boulud, je l’observais tous les soirs s’extraire de sa BMW, coiffé de sa toque, pour aller superviser les opérations du restaurant qu’il tenait à New York. Il m’a donné envie de s’intéresser à lui. Il me fascinait. D’une manière générale, j’aime les documentaires sur l’art et la culture. La mode en fait partie : j’ai produit dix films pour les dix ans de la marque Chloé, et un travail sur les préparatifs des dix ans du Vogue italien. Une chance inouïe qui m’a permis de travailler avec Helmut Newton, Bruce Weber, etc.
Avez-vous quelques projets inaboutis ?
Oui, il reste des films que je regrette de n’avoir pu tourner : l’un sur Dash Snow, mais sa disparition est encore trop fraîche, trop cruelle pour son entourage ; un autre sur Ivo Pitanguy, pape de la chirurgie esthétique moderne, qui estime que “la beauté ne peut être parfaite”, et puis, par dessus tout, un portrait d’Heidi Slimane. Mais peut-être trouverais-je le moyen d’y parvenir !
Propos recueillis par Malika Maclouf, avril 2012.