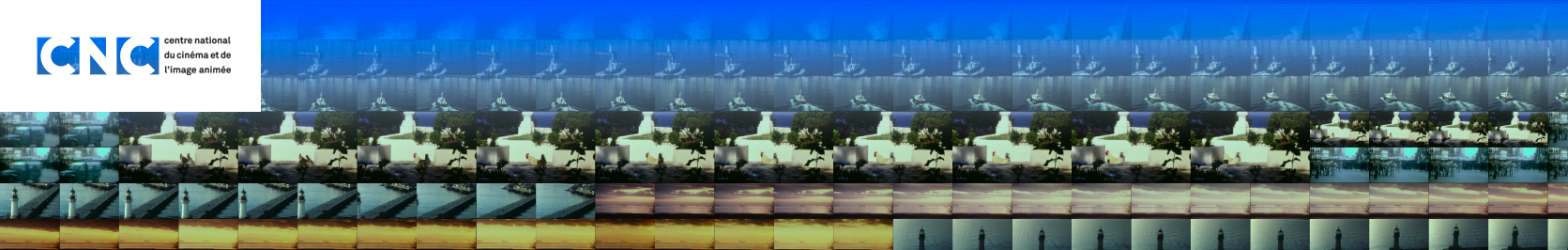24 heures chrono

Votre film Trabalho Escravo s’inscrit-il dans un projet militant ?
J’ai grandi dans une famille de militants révolutionnaires mais à l’adolescence, à la fin des années 1970, cette manière de faire de la politique m’est apparue comme un carcan et, par certains côtés, une impasse. À 19 ans, je suis parti sur les routes des Amériques pendant deux ans, pour voir un peu de la complexité du monde. Cela ne m’a pas détaché d’une vision matérialiste de l’histoire qui fait de l’égalité le seul horizon possible.
Quels sont vos liens avec l’Amérique latine ?
C’est un continent que j’ai connu par la littérature, le cinéma et la politique, à travers les réfugiés politiques que j’ai rencontrés enfant. Cela a façonné mon imaginaire et facilité mon apprentissage des langues. J’étais toujours du côté des Indiens plutôt que des cow-boys, mais à la manière métisse des Mexicains. C’est d’ailleurs le pays latino-américain que je connais le mieux. Avant ce film, je n’étais jamais allé au Brésil et je n’y suis pas encore retourné depuis.
L’esclavage par dettes, on en parlait déjà au Brésil dans les années 1960. Comment vous y êtes-vous intéressé ?
Le phénomène existe dans de nombreux endroits du monde, y compris en Europe. Au Brésil, ce système a été réactivé à la fin des années 1960 lorsque la junte militaire a cédé massivement des terres aux grands propriétaires. Aujourd’hui, il concernerait près de 100 000 travailleurs dans le Pará et le Mato Grosso. Il s’inscrit sur le fond d’une grande misère paysanne qui continuera tant qu’il n’y aura pas eu de vraie réforme agraire. Les recruteurs – on les appelle os gatos (les chats) – viennent embaucher dans les États les plus pauvres des paysans sans terre. Ils sont chargés sur un pick-up où ils voyagent debout pendant près de 2000 kilomètres. Dès qu’ils arrivent à la fazenda (grande ferme), ils sont redevables du voyage, puis des vivres et des outils. Leur seule garantie, c’est qu’ils auront à manger. Quand ils repartent chez eux, la plupart sont encore débiteurs. Au delà du travail-esclave, c’est la question de la terre en Amérique latine qui m’intéresse. En 2003, au Forum social de Porto Allegre, j’ai essayé de contacter les responsables du mouvement des paysans sans terre (MST) pour faire un film sur une communauté. Mais Lula venait juste d’être élu et le MST était tellement sollicité qu’il était inaccessible. Dans une conférence sur le travail-esclave, j’ai entendu le procureur du ministère du travail de Belém, Marcus Pereira Junior. Une intervention forte mais pauvrement illustrée. Je l’ai interviewé pour le site InfoAttac et lui ai proposé de faire un film.
Avez-vous tout de suite pensé accompagner une brigade de l’inspection du travail ?
Ces brigades ont une histoire intéressante : elles n’ont pas été créées sous la présidence de Lula mais sous Cardoso, sur pression du BIT (Bureau International du Travail). Constituées de fonctionnaires volontaires détachés de tout le Brésil, elles agissent au niveau fédéral car les plaintes, traitées auparavant par des juges locaux corrompus ou menacés, n’aboutissaient pas. Mais les groupes mobiles n’ont jamais eu vraiment les moyens de travailler à l’échelle du problème. En 2003, avec l’élection de Lula, ils avaient l’espoir de devenir plus efficaces. Ils ont été déçus.
Le début du tournage ?
Ça a été extrêmement rapide. De Porto Allegre à l’extrême sud, je suis allé à Belém, la porte de l’Amazonie, à l’extrême nord. Lors de la colonisation portugaise, Belém a été la première capitale historique du Brésil et le défrichement y a commencé très tôt. Le processus a pris dans la période récente une dimension industrielle. Dans le travail-esclave se conjuguent exploitation de la nature et exploitation des hommes. L’opération de la brigade du ministère du travail n’a duré que 24 heures. Tous les plans du film ont été tournés dans cette urgence. Il s’agissait pour moi de documenter la réalité du travail-esclave et l’action de la brigade. Le convoi part de Marabá à 6 heures du matin et la police, qui sécurise l’opération, n’est informée de la destination que le matin même pour éviter les fuites. Dès l’arrivée dans la fazenda, il faut rapidement réunir des preuves. Les travailleurs sont interrogés au plus vite avant que le propriétaire ne les cache.
Lorsque vous êtes entré avec la brigade dans la propriété, vous attendiez-vous à rencontrer plus de violence ?
Non, car sinon la brigade ne m’aurait sans doute pas laissé venir. J’étais lié à elle par un contrat tacite : me fondre parmi les fonctionnaires du Travail et me taire pour ne pas dévoiler mon identité d’étranger qui aurait pu invalider l’opération. Comme ils documentent eux-mêmes les opérations, je pouvais apparaître comme l’un des leurs. Dans cette exploitation relativement petite pour l’Amazonie (20 000 hectares), il n’y a pas de milice, juste quelques employés sous les ordres du gérant qui servent de nervis à l’occasion. Les propriétaires affrontent très rarement la police fédérale. Le risque serait disproportionné par rapport au coût des amendes et ils savent que, compte tenu de l’immensité du territoire et du manque de moyens des brigades, ils ont bien peu de risques d’être contrôlés deux fois.
Votre position de cinéaste “embarqué” vous a-t-elle posé quelques questions ?
Les contraintes étaient connues, il s’agissait de documenter l’opération dans ses différentes phases. Mon camp était choisi : c’était celui de l’État représenté par ces fonctionnaires remarquables. Bien sûr, j’étais dans une forme de sympathie. Mais la question essentielle pour moi était comment filmer des gens qui parlent, à quelle distance. Avec des contraintes techniques fortes : filmer seul avec un micro directionnel au-dessus de ma caméra. On n’entend que ce que j’ai filmé, ce qui rend le film assez sec, constitué de matériaux élémentaires. La seule latitude que j’avais était celle de la distance. Fixée d’abord par la distance des fonctionnaires eux-mêmes aux travailleurs-esclaves. Au cadre, j’ai cherché à inclure le plus souvent possible un travailleur-esclave et une inspectrice pour transmettre en particulier la vibration dégagée par Marinalva, la responsable de l’opération. Dès le matin dans la voiture, j’avais ressenti le contraste entre son allure robuste et la douceur de sa voix, qui participait de l’autorité qui émanait d’elle. À la différence de sa collègue qui laisse parfois percer sa colère, elle se contient. C’est d’une voix très douce qu’elle dit au propriétaire qu’il n’a plus qu’à obéir à la loi.
Vous deviez vous aussi tenir l’émotion à distance ?
Oui. Mais, j’étais tellement concentré que je ressentais une fluidité absolue. Au montage, j’ai mesuré à quel point mes antennes étaient déployées. Par exemple, quand un paysan parle du danger des serpents dans les hautes herbes, je filme déjà ses mains qu’il tortille nerveusement. A deux reprises dans le film, j’ai eu ce genre d’intuition, toujours étonnante a posteriori alors que je comprenais très mal leur portugais.
Il se passe parfois des choses étonnantes dans le cadre.
Quand quelque chose a lieu qui fait irruption, c’est cela que j’appellerais le cinéma ; par exemple, lorsque le patron surgit dans le cadre pour contester le témoignage de l’enfant. Ces moments ne sont pas prémédités mais ils sont rendus possibles par un dispositif. L’enjeu est de réussir à faire exister des corps. Dans Trabalho Escravo, on voit des corps qu’on n’a pas l’habitude de voir. Et l’on entend des voix. À celle de Marinalva, la responsable du groupe, fait écho celle du paysan au chapeau. Ces deux figures, investies d’une vraie autorité, sont les plus articulées. Dans un sens, elles produisent le film.
Ces travailleurs-esclaves vivent au ras de la survie. Ont-ils les moyens de se révolter ?
Dans le film, deux figures de travailleurs s’opposent. Le premier décidera de rester dans l’exploitation, l’autre, l’homme au chapeau, symbolise la prise de conscience. Un autre moment de cinéma surgit, je crois, lorsque Marinalva présente à tous les travailleurs-esclaves les termes de l’alternative. Soudain un homme se lève et avec lui, c’est l’espoir qui se lève : il se trouvera toujours quelqu’un pour dire non. L’aliénation est réversible, la prise de conscience est toujours possible.
Ces images tournées en 2003 ne sont devenues un film qu’en 2007. Pourquoi ce temps si long dans la production ?
Il s’agit d’une production indépendante jusqu’à l’autarcie, sans financement extérieur. Les expériences professionnelles que j’ai eues à la fin des années 1990 m’ont permis de mesurer le poids des contraintes qui pèsent habituellement sur les films. En tant qu’assistant-réalisateur en télé-fiction d’abord, puis confronté à un producteur autour d’un projet très fort écrit avec un ami sur la réhabilitation du quartier Belsunce à Marseille. En 2001, j’ai acquis les outils numériques qui rendaient possible de faire des films seul, ou presque. Mais il m’a fallu gagner ma vie autrement que par le cinéma. Cela combiné à une longue maladie a fait que le montage n’a pu commencer qu’en 2006.
Quels ont été vos choix au montage ?
En visionnant les rushes au retour, j’avais cru ne jamais pouvoir faire un film avec ce matériel. Pour monter, surtout seul, il faut que toute la dimension affective produite par l’exaltation du tournage retombe. En un sens, le temps écoulé entre le montage et le tournage m’a aidé à prendre de la distance. J’ai éliminé toutes les interviews tournées à Belém et Marabá. Du point de vue du cinéma, j’ai tout de suite compris qu’il fallait tendre au maximum le fil narratif et ne pas le diluer avec des commentaires. Rivé à l’opération, je n’ai pu tourner que très peu de plans de paysage et ces éléments de contexte spatial m’ont un peu manqué au montage. J’ai exploité mes rushes au maximum avec comme priorité de faire exister les corps et les voix. Au tournage, j’ai cherché à me placer dans une distance classique, celle de John Ford, qui est le seul auquel j’ai pensé dans la fazenda. J’ai été formé par la photographie directe, le document et le cinéma. Fiction et documentaire. J’aime le cinéma qui rend complexes les limites entre le réel et l’imaginaire. Ce sont des corps instables qui se contaminent perpétuellement. John Ford avait compris ça, je crois.
Au montage, j’ai traité ce matériel avec la même sorte de classicisme bricolé que les images. Montage cut, son direct. Plus une espèce de musique fabriquée pour le générique. Le fait de travailler seul, sans les contraintes habituelles d’une production permet de définir les contours de sa propre esthétique. Mais je n’en fais pas système car on mesure assez vite les limites de l’autarcie.
Vos films précédents ont-ils été réalisés dans les mêmes conditions ?
Oui. Eccentric Isles, mon film précédent est un road movie musical en Nouvelle Zélande, tourné en anglais. Le prochain projet documentaire sera sur un cinéaste indien bengali stupéfiant, auteur de huit films, Ritwik Ghatak (1925-1976). Je l’envisage dans un cadre économique plus classique, parce que le sujet le requiert, mais aussi parce qu’on fait des films pour qu’ils soient vus. Et même, pourquoi pas, pour en vivre ! Mais la question reste : à quelles conditions ?
Comment avez-vous composé cette séquence finale avec la guitare ?
Cette guitare, dès que je l’ai vue portée par un enfant dans la fazenda, m’a paru un fil possible, du côté d’une dimension métaphorique de la vie. C’est un samedi soir, il est 4 heures du matin, on traverse une petite ville où certains font encore la fête, on se dirige vers les faubourgs, on s’arrête devant une auberge très pauvre dont sort une femme ensommeillée. Le groupe de travailleurs qui a quitté la fazenda à 22 heures descend des camions dans la lumière des phares ; ils sont épuisés, mais excités aussi, parce qu’il y a eu une rupture dans le continuum de leur vie ; la fatalité s’est interrompue, au moins pour quelque temps. Je vois enfin la guitare, je m’approche. C’est le dernier plan. Mais, quand on filme, au sens du pur enregistrement, on ne compose pas. On décompose plutôt, on prélève des fragments, en espérant qu’ils seront suffisants au montage pour rendre la composition possible.
Comment le film a-t-il été reçu ?
Pour des raisons qui m’échappent, aucun festival brésilien n’a pris le film. En France, il n’a intéressé aucune chaîne de télévision. Peu étonnant au vu du traitement réservé la plupart du temps au documentaire. Traitement en amont avec le formatage des sujets et des styles puis en aval avec l’ajout systématique du commentaire et maintenant de la voice over. Le nom dit la chose : pour épargner au spectateur l’effort de lire les sous-titres, des voix de comédiens recouvrent désormais celles de ceux qui parlent. Cela s’apparente à des dispositifs de nature coloniale qui s’inscrivent dans un processus général. On cherche à faire du monde un parc de loisirs et, pour finir, un cimetière. Je suis du côté des voix (je dis bien voix) de traverse et du cinéma.
Propos recueillis par Éva Ségal, avril 2009.