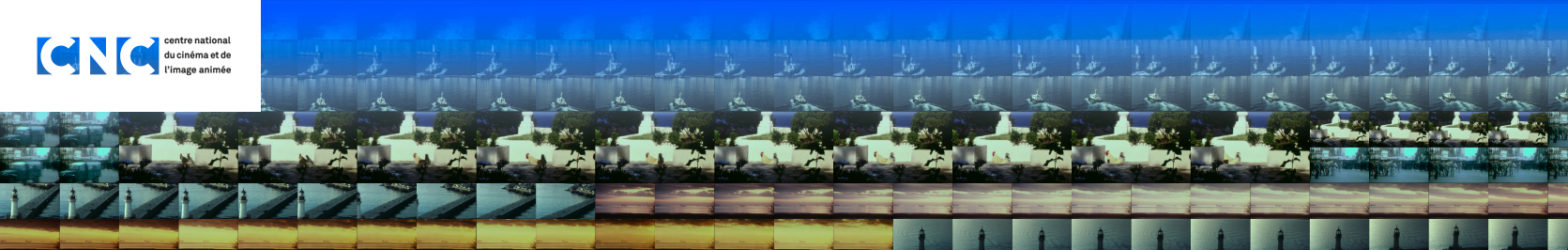Doux spleen triestin

Dans un garage, un jeune homme torse nu s’efforce d’emboîter un pneu dans un autre à l’aide d’un pied de biche. Si l’on ne saisit pas la finalité de la tâche, la séquence rend compte de la force physique qu’elle requiert. Comme l’Ulysse du poème d’Umberto Saba 1 ─ qui donne son titre au film — ce jeune homme, Adama, est arrivé par la mer. Mais comme Ajax, sa figure opposée dans la mythologie grecque, c’est par la force plutôt que par l’éloquence qu’il voudrait résoudre les obstacles dressés sur sa route de l’exil. Sa traversée depuis la Libye, il refuse d’en faire le récit tellement c’est “une sale histoire qui fait mal au cœur”. Il confie à la place un constat amer : “En Europe, on ne peut pas résoudre ses problèmes grâce à la force.” En effet, bien qu’il y ait investi beaucoup d’énergie, le projet d’acheminer des pneus usagés à Ouagadougou pour les revendre sur le marché d’occasion a fait long feu. L’histoire est racontée par son ami Alessandro : en dépit de la sueur versée, et de leur investissement commun, la petite joint venture imaginée pour gagner un peu d’argent a échoué. Si la force est inutile, que reste-t-il alors pour se débrouiller à Trieste aujourd’hui, quand on a trente ans et que l’on n’est pas un insider ?
Comme les pneus, les souvenirs sont rétifs à toute tentative d’empilement forcé. Comme eux, les mémoires, qu’elles soient burkinabé, italienne, macédonienne ou française, ont besoin de douceur pour être nouées ensemble.
C’est sans doute parce qu’il y serait davantage question de latence, de pudeur et de mélancolie que de puissance, de résolutions ou de lendemains qui chantent, que Jean Boiron Lajous a réalisé un film hivernal, choisissant d’envelopper ses personnages de ce timide soleil de février et de lumières grises sur la mer. Avec Terra di nessuno, il compose une partition sotto voce pour chœur fragile, celui que forment Adama, Alessandro, Biljana et Lisa. Un ensemble assez peu structuré, et dont les liens amicaux ne sont révélés que progressivement.
Œuvre chorale, Terra di nessuno s’ouvre pourtant par des récitatifs. Boiron Lajous filme chaque corps solo, tantôt voix in, tantôt voix off : celui d’Adama donc, celui de Lisa qui voyage sur les routes de France et d’Italie, sac au dos ; d’Alessandro qui, après une tentative d’émigration au Canada, est revenu vivre chez sa mère en attendant de trouver du travail ; de Biljana enfin, née en Macédoine, partie pour fuir une carrière toute tracée dans un pays qui se relevait de la guerre.
Au contraire d’Ulysse encore, toujours poussé vers le large par sa soif de connaissance, incapable de se fixer dans un port, ce quatuor essaie d’inventer une vie à quai, sans pour autant que Trieste ne soit la patrie d’aucun. “Terra di nessuno”, terre de personne, elle n’appartient ni à Lisa qui ne fait qu’y passer, ni à Adama qui rêve de retourner un jour au Burkina, ni à Biljana qui, malgré les années, a encore du mal à y faire sa place, travaillant pour trois fois rien dans un bar-restaurant associatif, ni même à Alessandro, le seul à y être né, mais qui n’est pourtant pas celui qui assume le récit de l’histoire de sa ville dans le film.
Cherchant à saisir par fragments ces sujets qui ont en commun l’expérience de l’arrachement, Boiron Lajous déambule en leur compagnie, les filmant souvent de dos : Adama effectuant des démarches pour renouveler son permis de séjour, Biljana rentrant chez elle après le travail, Lisa et Alessandro divaguant sur les quais… Le réalisateur est ici le suiveur, un Français qui a vécu à Trieste mais qui y reste l’invité, celui qui marche trois pas en arrière. Et qui filme au moyen d’une focale fixe revendiquée, pour ne pas tricher avec la notion de proximité, pour que la distance à l’image soit identique à celle de “la vraie vie”.
Une juste distance qui s’exprime dans les gros plans sur le visage de Lisa, qui disent la complicité conservée avec l’ex-petite amie ; une juste distance avec la nostalgie aussi ─ d’un séjour Erasmus effectué quelques années avant le tournage ─ et le temps qui passe (ou ne passe pas), matérialisés par le même plan monté trois fois : celui d’un vieux monsieur assis sur un banc et regardant sa montre. Ce pourrait être A, le cinéaste du Regard d’Ulysse de Théo Angelopoulos, originaire de Thessalonique, autre ville du nord d’un pays du sud, et comme Trieste, imprégnée de brumes, de frontières et de culture balkanique.
Sentiers de l’amitié
Mettant leurs pas dans ceux de James Joyce et d’Italo Svevo qui l’ont marquée de leur amitié, les personnages de Terra di nessuno arpentent la ville, et de leurs flâneries naissent à la fois l’ébauche d’un collectif et d’un rapport au territoire, à son histoire. A Trieste, ville “à l’identité de frontière” selon l’expression de Claudio Magris, les traces de l’histoire se cachent souvent dans des plis de cartes. Et les signes sont parfois trompeurs. Ainsi, Lisa imagine que l’inscription Spagnoli gravée sur un mur signale l’existence d’un ancien ghetto juif, quand elle ne renvoie, en réalité, qu’à l’adresse du sculpteur à qui l’on doit les statues des célèbres écrivains qui jalonnent les rues.
Pour approcher les cicatrices laissées par l’histoire, il faut quitter le centre-ville et grimper jusqu’au sommet du Carso, le plateau calcaire qui surplombe l’Adriatique. Là-haut, Jean Boiron Lajous filme ses personnages marchant sur le sentier de l’amitié, le long de la frontière italo-slovène. Autour de la table d’un refuge, un jeune homme retrace pour ses camarades l’histoire des Triestins massacrés en guise de représailles par les partisans de Tito en 1945, et dont les corps ont été jetés dans les foibe, les grottes du Carso. Si ”Trieste est une ville où l’on peut être triste en paix”, comme le dit Alessandro, c’est peut-être parce que des fantômes plus nombreux qu’ailleurs y veillent sur nos chagrins. Ceux des victimes des milices titistes sont venus grossir les rangs de ceux qui planaient déjà sur le vieux port d’une Mitteleuropa engloutie. A cette ronde se joignent aujourd’hui les silhouettes de bronze de Joyce, de Svevo et de Saba, qui semblent se donner la main pour accueillir une nouvelle génération de spectres : ceux qui hantent la mémoire des rescapés de la guerre en ex-Yougoslavie ou d’une traversée clandestine de la Méditerranée.
Après cette belle séquence sur les collines du Carso, Boiron Lajous ouvre le cinquième et dernier chapitre du film, intitulé Terre de feu, par des images de la ville battue par de violentes bourrasques de vent. Mais s’il filme les prémices d’une tempête de bora, il laisse ouvert le champ des présages dont il la charge. Le vent du nord soufflera-t-il pour dissiper l’humeur mélancolique de Trieste ? En chasser les fantômes ? La tempête annoncée est-elle la métaphore de celle qui menace le continent européen ─ dont l’union est ébranlée par l’afflux de migrants à ses portes et la poussée des nationalismes ? Ou au contraire, l’onde de choc salutaire qui viendra dénouer les situations d’attente et de frustration des personnages ?
Dans un article paru quelques mois avant sa mort 2, Pier Paolo Pasolini déplorait la disparition des lucioles, accusant la pollution d’avoir privé la nuit italienne de ce scintillement lumineux, et par conséquent de cet émerveillement intact, expérience esthétique nous reliant à tous les hommes l’ayant éprouvée depuis des millions d’années. Symbole d'une humanité menacée d'extinction, le minuscule coléoptère est aussi pour Pasolini la métaphore du désir qui illumine les visages des amants, la nuit.
Quarante ans plus tard, Jean Boiron Lajous filme ses personnages vagabondant et fumant des joints sous les étoiles. Mais s’il est certain que leurs visages ne sont pas ceux de “singuliers engins qui se lancent les uns contre les autres”, produits par la société de consommation que dénonçait Pasolini, Boiron Lajous ne cherche pas pour autant à les ériger en lucioles d’une résistance ou d’une révolution à naître. La piazza dell’Unità de Trieste n’est ni la place Syntagma ni la Puerta del Sol : la plus grande place d’Europe ouverte sur la mer attend toujours ses Indignés.
Communauté fragile, Alessandro, Lisa et leurs amis ne sont pas les hérauts de la contestation de l’ordre européen, de sa politique migratoire ou économique. Ils sont des jeunes gens aux desseins en construction, des outsiders souvent désœuvrés et pour lesquels même les contours de l’utopie restent à préciser. Comme s’il s’agissait d’espaces disponibles, Boiron Lajous filme des corps en devenir, cherchant à habiter le monde sans savoir au moyen de quel projet encore. Plutôt que de vouloir leur donner forme, Terra di nessuno se veut une chambre d’écho de ces potentialités ouvertes, et cherche à accorder le rythme de son montage au flux de la poésie aléatoire des soirées improvisées. Comme dans cette ultime scène où, autour d’un feu de camp, Lisa, Alessandro, Biljana et leurs amis entonnent une version fracassée de Let it be, devenue Lady Di. Comme si les paroles de la chanson des Beatles, qui prétendent par l’évocation d’une sage figure maternante réconforter “les gens dans le monde qui ont le cœur brisé”, collaient tellement à leur situation qu’il faille les détourner, les parodier. Si Terra di nessuno reconnaît le pouvoir fédérateur d’un refrain des années 1960, il nous dit aussi qu’Adama, Lisa, Alessandro et Biljana, tous précocement informés de la brutalité et de la violence du monde ─ à l’instar de la princesse au destin tragique ─ ne sauront reprendre au pied de la lettre les voies tracées par d’autres, dans un autre siècle.
Céline Leclère, avril 2018.
1 Aujourd’hui mon royaume
Est cette terre de personne. Le port
Pour d’autres allume ses feux ; l’esprit
Indompté me pousse encore au large,
Et de la vie le douloureux amour.
2 Le vide du pouvoir en Italie, Corriere della sera, 1er février 1975.