La liberté était notre socle
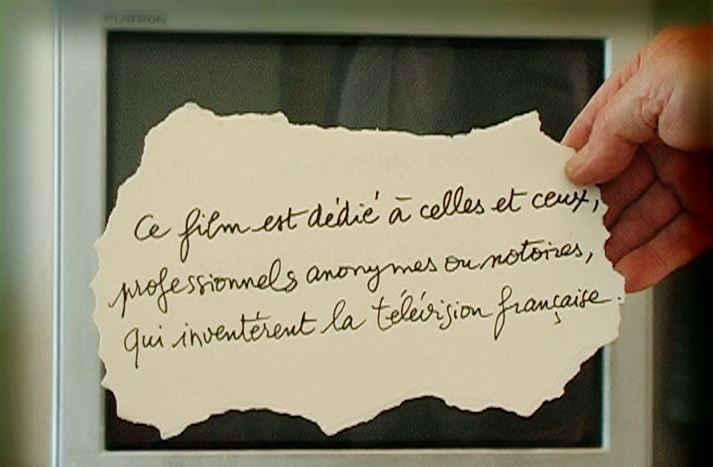
A la fin de votre film, vous parlez de la télévision d’aujourd’hui comme d’une “foire d’empoigne, sillonnée par des forains impudents et des icones électroménagères épinglées sur les téléviseurs, lesquels sont devenus des micro-ondes où l’on fait réchauffer le consensus avant de passer à la plonge idéologique”. D’après vous, la télévision a-t-elle perdu tous ses idéaux ?
Je ne parle d’ailleurs plus de télévision, je parle de téléviseur maintenant. Au tout début des années 1950, lorsque les téléviseurs étaient rares, dans les villages, on organisait des projections publiques. La communauté était activée dans le bon sens, les uns regardant les autres, les uns écoutant les autres, s’exprimant à propos de ce qu’ils pouvaient voir et entendre. La communication sociale était la résultante de cette situation concrète. Soixante ans plus tard, la situation n’est pas du tout la même. Dans une famille, chaque membre quasiment a son téléviseur. Le téléviseur est devenu un lieu de diffusion d’images animées et sonores, en couleurs, de quelque origine qu’elles soient. La télévision aurait dû être utilisée comme un instrument de sociabilité où chacun aurait vu et entendu l’autre, aurait pu à la face de la communauté donner son opinion sur ladite communauté, sur sa gestion, ses pratiques. Cette notion-là s’est évaporée dans les décennies qui ont suivi son arrivée. Dans les années 1950-60, il y a encore l’illusion d’une télévision, avec les dramatiques de l’Ecole des Buttes-Chaumont, les grands documentaires. Sur le plan du documentaire par exemple, la télévision a été en avance sur le cinéma. Avec des hommes comme Jacques Krier ou Marcel Bluwal, la télévision parcourait la France en donnant la parole aux anonymes. Mais rapidement, le téléviseur s’est réfugié dans les studios inventés par le cinéma, pour parfaire les conditions sonores et visuelles, maîtriser la lumière, le son. Le seul studio de télévision valable à mes yeux, ce sont les lieux de vie et de travail, c’est la réalité, rien d’autre. Les pouvoirs, l’Ordre, se sont emparés de cet instrument et petit à petit en ont fait le lieu de leur propre parole. Le téléviseur aujourd’hui n’est plus effectivement qu’un “micro-ondes où on réchauffe le consensus”. On tient ainsi clos le couvercle de la marmite sociale. Les “icônes électroménagères” sont ceux et celles dont le métier est d’apparaitre et de “touiller” les émissions. Emissions qui sont de moins en moins de “l’en direct” – comme tout est pratiquement filmé à l’avance, ça n’est plus une “émission”, c’est un vidéogramme. Les aléas de la réalité ont moins de chance d’y apparaître. En plus, on maîtrise soi-même son programme puisqu’avec des DVD on peut maintenant avoir sa consommation personnelle d’images à volonté. Il y a de rares exemples historiques, notamment ce philosophe qui avait quitté le plateau d’un direct dans les années 1970 [Ndr : le 13 décembre 1971, au cours de l’émission À armes égales où il devait débattre avec Jean Royer, Maurice Clavel découvre qu’un passage du reportage où il évoquait les sentiments, selon lui ambigus, du Président Pompidou envers la Résistance, a été coupé au montage. Outré par ce qu’il considère comme de la censure, il quitte le plateau avec fracas et, s'adressant aux producteurs, leur lance un “Messieurs les censeurs, bonsoir !”[] qui fera la Une du Nouvel Observateur]. J’ai fait quelques expériences dans les années 1980-90 de télévisions locales où, effectivement, on retrouvait le sens que je donne à la télévision : un lieu d’émission où n’importe quel citoyen peut rejoindre le studio et donner son opinion sur ce qu’il vient de voir et d’entendre, et engager la controverse si nécessaire. Il n’y a que dans la controverse que les communautés peuvent s’améliorer. Ce n’est plus du tout ce que les “icônes” que l’on voit dans les téléviseurs aujourd’hui sont chargées de faire. Elles sont chargées de divertir, de faire diversion.
Justement, ces chaînes locales, comme Télécité, Téléssonne, qui vont à la rencontre du citoyen, avec très peu de moyens, sont désormais accessibles à tous avec le numérique. Pensez-vous que l’on retrouve là les ambitions initiales de la télévision ?
J’ai fait un certain nombre de préfigurations de télévisions locales, entre 1984 et 1991, mais ces télévisions prennent vite aussi de méchants plis. Il y a aussi Zaléa TV à Paris et sur la région parisienne, à laquelle j’ai participé, ou Télé Bocal qui, effectivement, est plus libre. L’intérêt est toujours dans cette interaction : qui regarde ? Et qui diffuse ? Celui qui diffuse n’est l’élu de personne, il n’est pas plus que vous ou moi, donc je peux entrer dans son studio s’il m’y invite. Peut-être s’est-on bercé d’illusions. Je cite souvent cette définition de la télévision d’André Leroi-Gourhan : “Voilà une machine qui apporte chez nous le geste et la parole des hommes, et qui nous tient devant, immobiles et muets.” C’est là le véritable dilemme. Et il disait ça dans les années 1960. Dans les années 1950 déjà, André Robin disait aussi : “Voilà une machine à regarder qui pourrait bientôt fabriquer une race inédite d’aveugles.” Je souscris absolument à cette définition. En définitive, la télévision sécrète purement et simplement de l’idéologie. Quand je parle de “consensus”, c’est exactement ça, surtout, que rien ne déborde ! Les citoyens sont sous perfusion idéologique, qu’ils le veuillent ou non. Ils peuvent protester devant leurs téléviseurs, mais tant qu’on les tient devant, ils ne sont pas dans la rue pour manifester.
Vous évoquiez une idée de programme qui obligerait les gens qui regardent leur télé à l’éteindre…
Ce projet d’émission qu’on avait imaginé au début des années 1970 avec Jean-Charles Lagneau, un camarade réalisateur, avait une particularité. Elle était en direct et c’était une compétition entre deux équipes, une compétition pacifique, bien sûr. Ces deux équipes frappaient aux portes des villages ou des quartiers qu’elles traversaient pour demander de l’aide aux citoyens. On pouvait imaginer que celui qui regardait l’émission, s’il était pris d’un bon sentiment, éteignait son poste pour descendre dans la rue et porter assistance. Voilà une émission qui demande à qui la regarde de cesser de la regarder, de quitter la fiction télévisuelle pour entrer solidairement dans la réalité. C’était une métaphore. La télévision devrait être un instrument qui ramène sans cesse le citoyen à la découverte de ses contemporains.
Dans votre film, vous parlez de l’évolution des techniques, entre autres celles des caméras, qui ont changé les modes de réalisation.
Aujourd’hui, on a abouti à l’extrême dans la miniaturisation des outils, notamment la caméra. Mais le stylo ne fait pas le poète ! Regarder les talk-shows vous en convaincra : “Si je ne montre pas qui parle quand il parle, je risque le chômage.” Ça forme des réalisateurs dociles. Quand j’étais en régie, celui qui se serait permis de me faire ce genre de remarque, je l’aurais chassé à grands coups de pied au cul ! Certes, je suis le réalisateur de télévision qui a été le plus remercié de l’Histoire ! Les producteurs m’ont écarté maintes fois parce que, précisément, ils ne savaient jamais ce que serait ma première image… Et je ne le savais pas moi-même, sinon j’aurais arrêté de faire ce métier. C’est un goût personnel pour l’improvisation, alimenté par un désir de réel. Vous vous retrouvez dans un studio où il n’y a qu’un cyclorama tout gris et une échelle au lointain ; on vous dit que Jacques Brel arrive. Il commence à chanter Ces gens-là et on ne voit pas Brel, on voit juste une échelle ; la caméra passe lentement sur le décor avant d’arriver sur lui. C’était ça, Discorama !
Cela ne devait pas forcément plaire.
Aujourd’hui, tout le monde reparle de Discorama. Grâce, notamment, à Denise Glaser et à son talent. Quand je suis arrivé en 1964, j’ai un peu bouleversé la forme de l’émission. Tous les chanteurs aimaient passer dans le studio, autant pour rencontrer Denise que pour être filmés. La liberté était notre socle. Je n’aurais pas pu faire ce métier dans les conditions d’aujourd’hui.
Les premiers techniciens de la télévision venaient du cinéma ; ils ont eu à créer une esthétique, un langage. Aujourd’hui, alors que la télévision diffuse en 16/9e, qu’est-ce qui différencie son esthétique de celle du cinéma ?
Dans une interview pour L’Humanité en 1966, j’avançais : “La télévision est au cinéma ce que le journalisme est au roman” et ce qui s’y écrit obéit aux mêmes lois grammaticales. En ces années 1950, les studios Cognacq-Jay furent équipés de quatre caméras pour que le montage en direct permette de retrouver la syntaxe cinématographique. Champ-contre-champ, avec amorce ou sans, s’alternaient à l’envi, jusqu’aux gros plans qui fleurirent bientôt. Ainsi s’affirma la rhétorique télévisuelle. Il y a eu deux exceptions dans les années 1960 : Jean-Christophe Averty et moi-même (ici je ne hausse pas du col, même si je n’ai de leçon d’immodestie à recevoir de personne). Jean-Christophe a inventé, ou plutôt rétabli le blanc et noir purs, alors que dans les téléviseurs en noir et blanc les gris seulement dominaient. Il impose le blanc. Il n’y a plus de profondeur de champ. C’est une mise en page et non plus une mise en scène ; la troisième dimension est abandonnée, et de plus, il fractionne l’écran. Et ça reste du langage cinématographique ! Jean-Christophe a toujours cru qu’il faisait de la télévision parce qu’il utilisait l’électronique. Non, Il faisait du cinématographe électroniquement ! Pour ma part, en commençant Discorama en 1964, je considère le studio comme un atelier de travail et non plus comme un lieu de magie ; on y voit des échelles, des ouvriers, des femmes de ménage, des projecteurs… C’était rigoureusement l’inverse de ce que faisait Jean-Christophe. On m’a dit alors que j’étais “rustique”, voire “cul-terreux”… Certes, mais avec style, affirme-t-on aujourd’hui !
La télévision aujourd’hui a un certain rythme, une rapidité…
Il faut aussi se méfier de la rapidité : comme le geste des magiciens, l’illusion est camouflée par la rapidité de l’exécution. Aujourd’hui, ordre est donné de ne pas faire de plan de plus de quatre ou cinq secondes. Compte tenu de cela, à partir des années 1970, j’ai commencé à faire des plans très longs. Même à l’époque de Discorama, une chanson pouvait être contenue en un seul plan. Et puis je suis allé plus loin, j’ai fait les “plans films” : La Passion selon saint Matthieu, par exemple, en 58 minutes, entre la Porte de Pantin et la Porte des Lilas. Pour Zaléa TV aussi : je réunissais des amis ou des inconnus, qui parlaient de l’actualité avec des journaux sur la table où ils pointaient leurs sources. Un seul plan de 30 minutes : autour d’eux, entre eux, m’approchant des documents dont ils parlaient. Filmer en continuité est une manière d’hommage à l’attelage de l’espace et du temps. Je pense qu’on s’éloigne de cette télévision agora où le citoyen exercerait son droit au débat. Il faut admettre que l’autre peut avoir des points de vue qui enrichissent le vôtre, mais peuvent froisser votre ego. On ne demande à personne d’être parfait ; quand je dis “personne n’est parfait”, j’ajoute toujours “et je suis du nombre” !
Propos recueillis par Caroline Terrée, septembre 2009.


